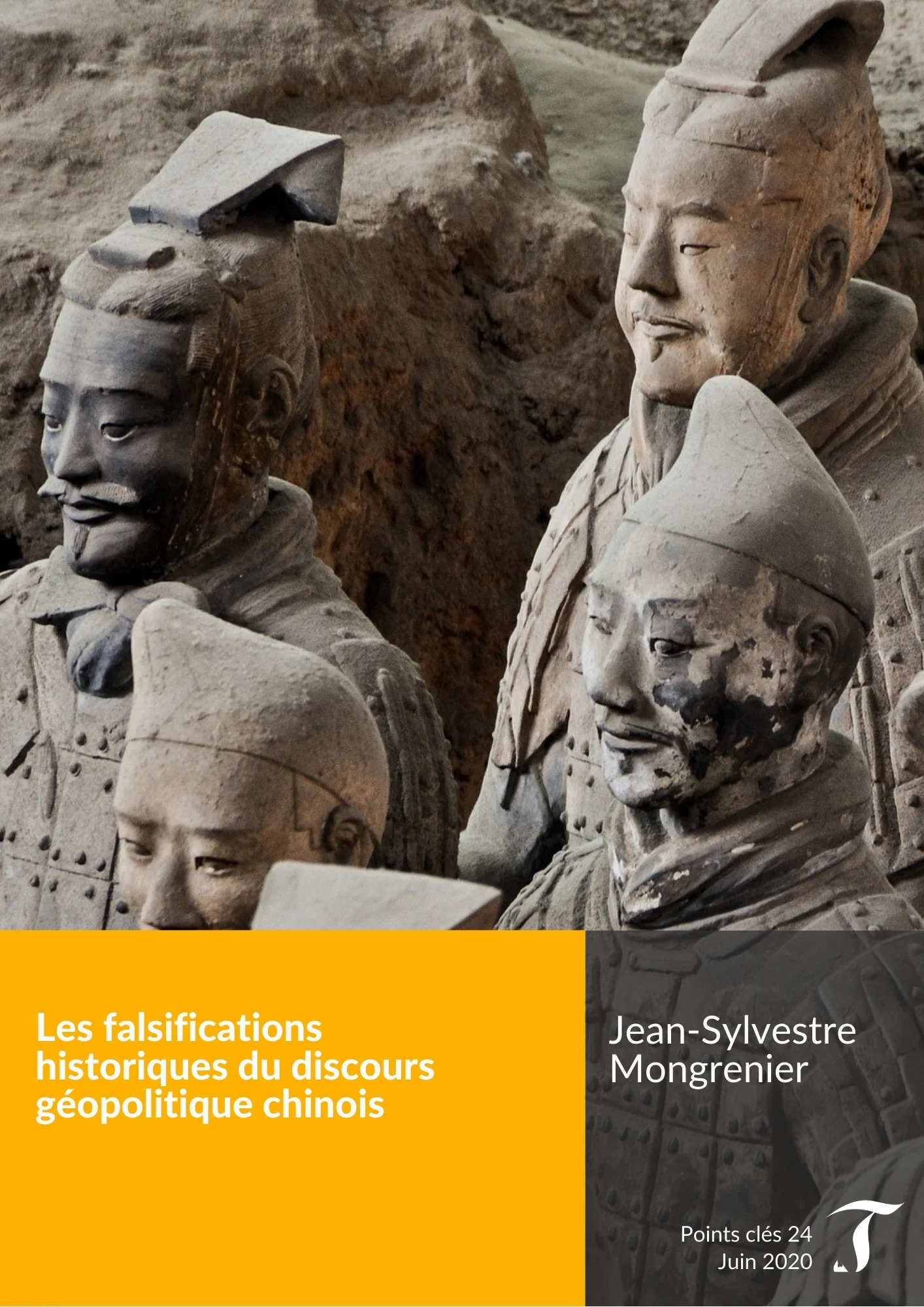Juin 2020 • Points clés 24 •
Juin 2020 • Points clés 24 •
La géopolitique, en tant que méthode et discours, comporte une importante dimension historique. Aussi ne s’étonnera-t-on pas que la diplomatie publique et culturelle de la République populaire de la Chine recoure à des images et des arguments du passé afin de justifier le déploiement planétaire de sa puissance. Les biais et les différences de point de vue sont par ailleurs naturels. Encore ne faudrait-il pas que le relativisme des sociétés occidentales post-modernes se transforme en adhésion pure et simple à un discours historisant bien souvent contestable, voire mensonger. Un certain nombre de rectifications s’impose donc. Cette note se propose de le faire sur dix propositions contrefactuelles ou approximatives…
Si le communisme voulait faire table rase du passé, la République populaire de Chine (RPC) n’en revendique pas moins « 5 000 ans d’histoire ». Cette Chine éternelle serait par nature stable et pacifique, n’ayant jamais livré de guerre autre que défensive, contre des peuples barbares. C’est l’irruption des puissances occidentales, au XIXe siècle, qui aurait introduit le mal dans cet Empire du Milieu, présenté comme une superpuissance avant l’heure. Commence alors le « siècle des humiliations ». Enfin Mao Tsé-Toung et le Parti communiste chinois (PCC) vinrent. Ils sont censés faire entrer la Chine dans la modernité afin de renouer avec sa position centrale.
Secrétaire général du parti, président de la Commission militaire centrale et chef de l’Etat, Xi Jinping nourrit le dessein de conduire à terme ce long mouvement historique. Dès avant 2049, centenaire de la fondation du régime communiste, la Chine populaire aura renoué avec sa cosmologie impériale et retrouvé sa prééminence mondiale. L’essentiel de la vision historique qui règne à Pékin et dans les esprits chinois tient en quelque cent cinquante mots. Et le quidam occidental de s’étonner devant une telle science du passé, d’autant qu’elle fait écho au relativisme et au nihilisme qui mine notre « modernité tardive ». Un problème cependant : ce discours mêle le mythe, l’approximatif et le faux pour justifier la volonté de puissance de Pékin et ses objectifs concrets. Aussi importe-t-il de connaître la réalité historique de la Chine.
1. « La Chine a 5 000 ans d’histoire ». Le slogan confond délibérément histoire, préhistoire et mythe
Cette affirmation à prétention historique est censée étayer le discours de Xi Jinping sur le « rêve chinois ». Martelée d’un bout à l’autre de la Chine populaire, exportée dans le monde entier par la diplomatie publique de Pékin, elle a pris la forme d’un slogan. En vérité, les cinq millénaires mis en avant nous projettent dans le champ du mythe, celui de l’Empereur Jaune (Huangdi), qui selon la tradition aurait régné au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Souverain civilisateur régnant sur le mont Kunlun, l’Empereur Jaune est le maître du tonnerre et de la pluie. Il est à l’origine de l’architecture, de la métallurgie, de la médecine et de l’art de gouverner. Son épouse enseigne aux femmes l’élevage des vers à soie. Selon certains mythographes, l’Empereur Jaune serait en fait le dieu Tonnerre des Tokhariens, un peuple indo-européen de Sibérie et d’Asie centrale qui a vécu dans la partie septentrionale du bassin du Tarim, au Sin-Kiang (Xinjiang) (1). L’archéologie a d’ailleurs montré l’importante influence des Scythes, Tokhariens et autres peuples des steppes dans la genèse des techniques et des formes culturelles dans la partie septentrionale de la Chine actuelle, la recherche contredisant le sino-centrisme en vigueur (2).
C’est à l’époque des Royaumes Combattants (453-221 av. J.-C.) que l’Empereur Jaune est « assimilé » par les Chinois. Il gagne en importance sous la dynastie Han (206 av. J.-C./220 ap. J.-C.), les chroniques s’y référant plus systématiquement. Surtout, le nationalisme de Sun Yat-sen (1866-1925) érige l’Empereur Jaune en père de la civilisation chinoise, voire en mythe racial. Ce n’est pas de l’histoire, ni même de la proto-histoire ou de l’archéologie. En ces temps lointains auxquels renvoie le mythe, différentes cultures néolithiques se juxtaposent et se succèdent dans le Nord de la Chine actuelle : il serait anachronique de voir dans les porteurs de ces cultures, liés par les échanges et les techniques aux populations sibériennes et centre-asiatiques, le prototype du Han. C’est au cours de l’âge du Bronze (XVIIIe- VIe siècle av. J.-C.) que la civilisation chinoise commence à prendre forme. Dans ses Analectes ou Entretiens, Confucius se réfère principalement à la dynastie
des Zhou (1121-256 av. J.-C.), bien plus qu’aux souverains légendaires qui la précèdent (3). In fine, les échelles temporelles sont comparables à celles du Proche-Orient antique, de la Grèce et du monde égéen, voire de l’Europe celtico-nordique. Sur le plan de la géohistoire et des racines longues-vivantes des civilisations, la Chine doit même céder le pas à l’Egypte ancienne et contemporaine.
2. « L’Empire chinois est par nature pacifique et n’a jamais mené que des guerres défensives ». L’expansion guerrière originelle et la formation territoriale de l’empire démontrent l’inverse
La fascination de l’Europe classique, puis de certains philosophes des Lumières, pour la Chine, la diffusion plus tardive des écrits de Sun Zu (« Vaincre sans combattre ») et l’idéologie victimaire du nationalisme chinois moderne ont amplement véhiculé l’idée d’une Chine pacifique. Tout au plus aurait-elle été conduite à se défendre par les armes. Dans le même registre, voici peu encore, certains expliquaient que la Chine n’étant pas universaliste, il ne fallait pas redouter sa montée en puissance et ses effets extérieurs. En opposition à cette thèse d’un monde chinois équilibré et somme toute pacifique, les travaux archéologiques ont depuis révélé le caractère sanguinaire des guerres menées sous la dynastie Zhou (1121-256 av. J.-C.). Par la suite, l’époque « Printemps et Automnes » (722-481 av. J.-C.) et celle des « Royaumes Combattants » furent marquées par des conflits hyperboliques entre des principautés rivales, rois et princes militarisant la société (4). Sous cet aspect, les théories stratégiques de Sun Zu (5) ne rendent pas compte de la réalité historique : jeux diplomatiques, espionnage et subversion de type intra-culturel, ruses et stratagèmes, n’excluaient pas le recours à la force armée.
C’est par la guerre que le roi Zheng unifie l’espace chinois (221 av. J.-C.). Dès lors, il porte le titre de « Qin Shihuang » (le « Premier Empereur »). Découvert à Xian, en 1974, le tombeau de Qin Shihuang, avec les 7 000 cavaliers et fantassins de terre cuite qu’il contient, donne idée de sa puissance. Depuis le bassin du fleuve Jaune, noyau géohistorique des Han, les conquêtes territoriales se font en aval et dans les plaines septentrionales. Elles sont ensuite tournées vers le sud, en Asie des Moussons. Parallèlement, les conquêtes se portent vers la Haute-Asie et le Turkestan, espaces de confrontation avec les peuples tibéto-birmans et turciques ; il faudra attendre la dynastie Qing (1644-1912) pour que l’Empire du Milieu conquière effectivement ces espaces. Quant aux peuples de la périphérie, ils sont réputés barbares (yi), et réduits à l’état de tributaires, ou bien sont considérés comme tels (la tradition chinoise distingue les « Barbares cuits » des « crus », ces derniers étant réputés inassimilables). Dès ses origines, l’histoire de l’Etat-civilisation chinois s’inscrit dans le cadre de frontières mobiles et conquérantes. Notons ici que les souverains d’ethnie Han ont été régulièrement vaincus par des ennemis inférieurs en nombre. Ce sont leurs vainqueurs, notamment la dynastie mandchoue des Qing, qui ont repoussé les frontières de l’empire dont ils avaient fait la conquête (6).
3. « La Chine constitue de longue date un ensemble unitaire ». Désagrégation géopolitique, pluralité des centres de puissance et luttes internes ont marqué l’histoire chinoise
Si le bassin du fleuve Jaune est précocement unifié (221 av. J.C.), encore ne faut-il pas omettre pertes territoriales et périodes de décomposition. Après quatre siècles d’unification sous la dynastie Han (206 av. J.-C.-220 ap. J.-C.), l’Empire de Chine se désagrège au cours d’une période de longueur équivalente à celle qui précède. Durant l’époque des Trois Royaumes, les Wei au nord, les Wu au sud-est, les Shu dans le bassin du Sichuan, se font la guerre (220/280). Dans les trois siècles qui suivent, une ligne de fracture entre Nord et Sud partage la Chine. Sur cette toile de fond, six dynasties sont aux prises. Vient l’époque des Seize Royaumes (304-439), celle des Dynasties du Sud et du Nord (420-589). La réunification intervient sous la dynastie Tang (618-907). Ensuite, une nouvelle période de désagrégation, dite des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, fait le pont avec les Song (960-1279). Ces derniers perdent le contrôle de la partie septentrionale de la Chine, intégrée à des empires nomades issus du monde de la steppe. Ainsi les Jürchen, ancêtres des Mandchous, s’emparent-ils du berceau de la civilisation chinoise et lancent-ils des offensives jusqu’au fleuve Bleu (le Yang-Tsé-Kiang). Les Song en sont réduits à leur payer tribut. C’est alors que Pékin devient la « capitale du nord ». Par la suite, les dynasties Yuan (1279-1368), Ming (1368-1644) et Qing (1644-1912) se révèlent plus solides (7).
Sur le plan territorial, l’Empire des Qing atteint un apogée : ses frontières préfigurent celles de la RPC. A rebours de l’idée selon laquelle la Chine aurait toujours conquis ses conquérants, la New Qing’s History appelle l’attention sur le caractère mandchou de cette dynastie, à la tête d’un empire multi-ethnique : l’Empereur portait les titres de « Fils du Ciel », de « Khan des Khan » et de « Chakravartin ». Au cours du second XIXe siècle, la révolte des Taiping, les rébellions Nian et Hui provoquent la sécession de provinces entières, et ce durant de longues années (Point 5). Après la révolution de 1911, potentats régionaux et « seigneurs de la guerre » défient le gouvernement central. Lancée en 1926, l’« Expédition du Nord » (la Beifa) conduite par Tchang Kaï-chek permet de réunifier une partie du territoire chinois ; le généralissime doit cependant composer avec un certain nombre de « Seigneurs de la guerre » (junfa) et il ne contrôle pas la Mandchourie, le Tibet et le Sin-Kiang (Xinjiang). Après la « décennie de Nankin » (1926-1937), viennent la guerre sino-japonaise (1937-1945) et la deuxième guerre civile (1945-1949) qui déchirent le territoire chinois. De fait, le Parti communiste chinois réunifie l’espace impérial autrefois conquis par les Qing. Le stratégiste américain Edward Luttwak souligne le paradoxe historique : « Sous les Mandchous, la Chine n’était rien de plus qu’un territoire conquis parmi d’autres (…). De nos jours pourtant, les Han ont le sentiment d’être propriétaires des terres non han conquises par les Mandchous – comme si l’Inde pouvait avoir des prétentions sur le Sri Lanka car tous deux étaient aux mains des Britanniques » (8).
4. « La Chine est une superpuissance au cœur de l’histoire universelle ». Puissance asiatique, la Chine n’a que tardivement eu les moyens d’une politique mondiale
Lors de ses phases unitaires, l’Empire du Milieu a bien imposé sa primauté en Asie de l’Est, sur ses contours et dans les profondeurs du continent (9). Partant de ce fait indéniable, d’aucuns expliquent que l’hypothétique accès de la Chine contemporaine au premier rang mondial, voire sa transformation en « superpuissance », ne serait que le retour du même. Initiés par Angus Maddison, les travaux de statistiques historiques de longue durée laissent penser qu’en 1700, la Chine représentait 23 % de la population humaine et 22 % de la production mondiale de richesses. Si l’on extrapole à partir des données macroéconomiques, la République Populaire de Chine ne ferait donc que retrouver sa place de première puissance mondiale. On confond ici l’effet de taille et la puissance, définie comme la capacité à imposer sa volonté à d’autres acteurs internationaux. La population chinoise de l’époque était essentiellement composée de paysans réduits à l’autoconsommation. Le surplus dégagé n’était pas suffisant pour financer une grande politique de puissance. Déjà supérieure dans le Nord-Ouest européen vers 1500, la richesse par habitant l’est de moitié un siècle plus tard. Et si l’Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, au moment où le roi George III envoie Lord Macartney en ambassade, est moins « lourde » que l’Empire du Milieu, l’innovation et le dynamisme sont de son côté : elle est destinée à l’emporter.
En d’autres termes, la pesée globale n’est pas la puissance, et la primauté historique de la Chine s’exerçait sur le seul théâtre asiatique. Quant à la thèse selon laquelle l’Empire du Milieu était le moteur de la mondialisation, elle n’a guère de sens. S’il est loisible de spéculer sur ce que la menée à terme des expéditions de Zheng He aurait pu produire (sept expéditions de 1405 à 1433), il s’agit là d’un exercice d’uchronie. Les Grandes Découvertes, les premières circumnavigations et la traversée en tous sens de l’océan Pacifique sont le fait des nations occidentales. Certes, la découverte de la civilisation chinoise et l’attraction de ses produits étaient de puissants mobiles. Il n’en reste pas moins que le commerce avec la Chine ne représentait qu’une fraction de celui réalisé dans l’océan atlantique, axe géopolitique de l’Occident moderne. Si l’on prend l’exemple des Etats-Unis, au milieu du XIXe siècle, la Chine représente bien les trois quarts du commerce réalisé dans le Pacifique, tôt identifié comme un « océan de la destinée », mais la part de ce commerce dans la totalité des échanges commerciaux américains est de moins d’un dixième. En rupture avec la thèse développée par certains historiens chinois, thèse complaisamment reprise par les tenants d’une « histoire interconnectée » qui dénient le rôle historique de l’Occident, il est faux d’affirmer que la richesse des marchands du Co-hong a financé le développement économique des Etats-Unis (10).
5. « Les guerres de l’Opium ont ruiné la Chine et moralement discrédité l’Occident ». Simplement qualifiés de « trouble » par les sources chinoises, ces conflits sont sans commune mesure avec les guerres intérieures
Lorsque les deux guerres de l’Opium se produisent (1839-1842, 1856-1860), l’Empire chinois est déjà engagé dans une spirale dépressive et, plus largement, un déclin à plusieurs dimensions. D’ethnie mandchoue, la dynastie Qing a atteint son apogée au XVIIIe siècle. Si la Chine a d’ores et déjà été distancée par la « révolution scientifique » (voir les travaux d’Alexandre Koyré) que connaît l’Occident, elle atteint sa plus grande extension territoriale, non point par subjugation culturelle, mais par le fer et le feu. Après un âge d’or (une « Pax Mandchourica »), la mort de l’Empereur Qianlong, en 1795, constitue un repère commode. La croissance démographique dépasse alors le potentiel économique du pays ainsi que la capacité d’encadrement de l’appareil d’Etat. Dans la grande dépression qui s’abat sur la Chine au cours de la première moitié du XIXe siècle, les facteurs endogènes sont les plus importants : famines et déforestation, sous-entretien des aménagements hydrauliques, gonflement de la population errante, crise du bimétallisme argent/cuivre ainsi que révoltes suscitées par la secte du Lotus Blanc qui mettent à sec le trésor impérial (1796-1804). Quant à l’opium, il est consommé et importé avant que des marchands-contrebandiers, britanniques, mais pas exclusivement, n’y voient le produit qui permettra de rééquilibrer les échanges avec la Chine (les importations de thé, de soie et de porcelaines sont réglées en métal argent). Une fois la marchandise acheminée jusqu’aux littoraux, ce sont des contrebandiers chinois, avec la protection de mandarins corrompus, qui contrôlent ce commerce (11).
L’interdiction impériale de ces importations vise non pas à endiguer un fléau sanitaire, mais également à empêcher les sorties d’argent métal. Si l’affaire aboutit à une guerre avec l’Angleterre, les enjeux sont plus larges que le seul opium : liberté du commerce, instauration de relations diplomatiques, liberté religieuse (12). Significativement, les sources officielles chinoises ne parlent que de « troubles de l’opium ». Autrement plus meurtrières et coûteuses sont les terribles guerres et insurrections intérieures : révolte des Taiping dans la basse vallée du fleuve Bleu (1850-1864), des Nian au Nord (1853-1868), des Turbans rouges dans la région de Canton (1854). S’y ajoutent des révoltes de Hui au Yunnan (1855), puis dans le Nord-Ouest (1862-1863 et 1876), des épisodes de guerre entre les Hakka (des Han du Nord ayant migré en Chine méridionale) et les populations locales. Ces conflits et leur répression font des dizaines de millions de morts. Il faudra l’appui des puissances occidentales et l’affirmation d’une élite politique et militaire provinciale pour que la dynastie Qing surmonte l’épreuve (13). La démographie chinoise subit les conséquences de ces pertes et les vides ne sont que progressivement comblés. La zone centrale de l’Empire, la plus peuplée et la plus riche, est ravagée. La nécessité de restaurer l’économie rurale a pour effet d’aggraver les charges sur le commerce et l’artisanat : de lourdes taxes sur la circulation cloisonnent l’espace, ce qui pèse sur les efforts de modernisation. Par le fait, la Chine tend à devenir un Etat centré sur l’agriculture, cette fiscalité jouant contre une politique active en faveur de l’industrialisation.
6. « La Chine s’est vue imposer d’injustes traités inégaux ». Le traumatisme réside d’abord dans l’instauration de relations diplomatiques sur un même pied
Si l’on considérait les choses du point de vue exclusif des rapports de force, il serait possible de pointer les « dénivellations énergétiques » qui, à certaines époques de l’Histoire, marquent les rapports entre différentes formations politico-territoriales. Induit en tentation, le plus fort impose sa loi au plus faible. Durant de longs siècles, les « traités inégaux » furent la règle entre l’Empire du Milieu et ses périphéries tributaires, sans revenir sur les conquêtes et les dommages que ces dernières causèrent. Qui s’en indigne aujourd’hui à Pékin ? Avec les guerres de l’Opium, le cours des événements fut autre : « History as usual ». L’analyse doit cependant aller plus loin que la simple religion du fait accompli. Il importe de comprendre que la cosmologie impériale mettait en scène des acteurs n’ayant pas le même statut ontologique. Au cœur d’une constellation de royaumes et de principautés tributaires, l’Empire du Milieu occupait une position éminente et il prétendait à une forme de monarchie universelle (voir le concept de « Tianxa » : « tout sous le ciel »). A l’inverse, l’Angleterre et les puissances occidentales entendaient traiter avec la Chine sur un pied d’égalité, à l’instar de ce qui se produisait dans le système westphalien. Les représentants diplomatiques qu’elles dépêchaient refusaient de se prosterner devant l’Empereur (le kowtow) et voulaient pouvoir ouvrir des ambassades permanentes à Pékin.
Si le traité de Nankin (1842) tient effectivement compte du rapport des forces issu de la première guerre de l’Opium, c’est surtout du fait qu’il soit fondé sur l’égalité de principe des parties signataires qu’il a traumatisé la conscience impériale chinoise. Dans la période qui suivit, les autorités chinoises s’appuyèrent pourtant sur les clauses de ce traité afin d’endiguer la pression anglaise. Conformément à l’antique stratégie qui consiste à « utiliser les barbares contre les barbares » (14), elles proposèrent d’elles-mêmes aux Américains ainsi qu’à d’autres nations occidentales de jouir des mêmes avantages. Dans le sillage du Mouvement du 4 mai 1919 (15), nationalistes et communistes chinois réinterprétèrent cette période : c’est alors que le thème anachronique des « traités inégaux » s’imposa. Il est vrai cependant que le statut d’extraterritorialité des sujets occidentaux instaurait des relations sans équivalent dans le système westphalien. Encore est-il bon de savoir que l’extraterritorialité était de coutume : le droit chinois étant sacré, il ne pouvait être appliqué à des « barbares ». Les Occidentaux ont su manœuvrer pour exploiter au mieux l’exclusivisme traditionnel des Chinois, l’institutionnalisation de l’extraterritorialité étant complétée par un système de territoires à bail (la méthode est reproduite par la Chine dans la péninsule de Corée). A la différence de la Russie et du Japon, les puissances occidentales n’ont cependant pas conçu de vastes programmes de conquêtes territoriales, moins encore songé à faire leur la cosmologie impériale chinoise (le Japon de l’ère Meiji se voit en nouvel Empire du Milieu) (16).
7. « Le Parti communiste chinois a mis fin au siècle des humiliations et il a modernisé la Chine ». Le maoïsme dur a interrompu une longue phase de modernisation ouverte au milieu du XIXe siècle, en liaison avec l’Occident
Du point de vue du Parti communiste chinois (PCC) et de l’école historiographique dominante en Chine populaire, la dynastie Qing (1644-1912), puis la République de Chine, instituée après la déposition de Pu-Yi (le « dernier empereur »), ont amplement manifesté leur impéritie au moment où la Chine devrait s’ouvrir plus largement sur le monde, selon des modalités qui lui échappaient. C’est le PCC qui aurait propulsé la Chine dans un avenir radieux. Ce paradigme historique occulte ou relativise les dynamiques internes du siècle qui précède la prise du pouvoir par Mao Tsé-Toung. Après les deux guerres de l’Opium, le gouvernement impérial a mené des « politiques d’autorenforcement » (ziqiang), soutenues par des conseillers occidentaux et mises en œuvre par des grands fonctionnaires provinciaux (des mandarins). La logique était celle d’une modernité instrumentale : importer les techniques et outils de puissance de l’Occident sans les valeurs et les institutions. La défaite lors de la guerre contre la France, avec pour enjeu l’Indochine (1884-1885), plus encore celle administrée par le Japon (1895) mettent en évidence les limites de cette « modernisation conservatrice » instrumentale. A la suite de la guerre des Boxers (1901), l’empereur Guangxu lance les « Nouvelles Politiques » (Xinzheng) (17). Menées tambour battant, ces politiques rénovent de fond en comble l’enseignement (suppression des examens mandarinaux, 1905) et préfigurent la constitutionnalisation de la monarchie (élection au suffrage censitaire d’assemblées provinciales, 1909). Le rythme et la radicalité de ces transformations expliquent pour partie la révolution de 1911-1912.
Bien que l’instauration de la République inaugure une nouvelle période de troubles, la conjoncture économique chinoise bénéficie bientôt de la Première Guerre mondiale et de ses effets (réduction de la concurrence occidentale et ouverture de nouveaux marchés en Europe). Au cours de la « décennie de Nankin » (1928-1937), le processus de modernisation s’accélère avec le développement des réseaux ferroviaires, la fondation de la place boursière de Shanghaï (1921) et la rénovation du système bancaire ou encore une réforme monétaire qui met fin à la dépendance de la Chine à l’égard de l’argent métal. Objet de recherches et de controverses historiographiques dans les années 1970 et 1980, la croissance économique chinoise des premières décennies du XXe siècle s’avère forte et vigoureuse dans l’ensemble. La concurrence et les investissements occidentaux ont stimulé le développement économique (18). Un capitalisme original et performant s’esquisse (19). Le commerce extérieur gagne en importance tandis que les capitaux étrangers affluent dans les grandes villes de la « civilisation côtière » des littoraux chinois. « Perle de l’Orient », Shanghaï constitue une métropole moderne et industrialisée, électrifiée et dotée d’un réseau de transport moderne, avec une architecture de pointe (construction de buildings). Longtemps obérée par la glaciation communiste, cette réalité met en perspective le développement de la Chine depuis les réformes de Deng Xiaoping (1982). Des réformes là encore étroitement liées à l’ouverture sur l’Occident. Il est possible de penser que, sans le long intermède maoïste, l’émergence économique de la Chine eût été plus précoce.
8. « Le confucianisme constitue le ressort de la Chine contemporaine ». L’invocation de Confucius ne saurait occulter le fait que le communisme chinois constitue une sorte de « légisme rouge »
Il n’est pas lieu ici de définir ce qu’est le confucianisme ou de traiter des influences taoïstes et bouddhistes sur cette sagesse, ensuite systématisée, puis érigée en doctrine d’Etat (voir le syncrétisme néo-confucéen produit sous la dynastie Song qui règne entre 960 et 1280). Lorsque la Chine fut confrontée au défi des puissances occidentales, ce syncrétisme constitua effectivement l’armature idéelle de la « modernisation conservatrice » menée par la dynastie Qing (voir le point 7). Qualifiés de néo-traditionnalistes, ses tenants se référaient au concept de « Ti-yong » : Ti : l’essence ; Yong : l’attribut (un double concept comparable à la dyade « substance-accident » de la pensée scolastique). Posée comme supérieure à l’Occident, la culture chinoise constituait selon eux l’essence de l’Etat et de la société (la substance). Quant à la science, elle n’était qu’un attribut (l’accident) et pouvait donc être empruntée à l’Occident. Après la défaite contre le Japon, le confucianisme est réinterprété et une fois de plus rénové. Tenant d’une nouvelle synthèse, Zhang Junmai (1887-1969) observe la critique en Europe de la modernité, et il y cherche un « poumon » intellectuel. Ainsi lit-il les écrits de Rudolf Eucken dont le néo-idéalisme et l’exaltation de l’esprit allemand débouchent sur une métaphysique de la germanité. Les thèses d’Henri Bergson sur l’« intuition philosophique » qui permettrait de saisir l’« élan vital » et d’atteindre la vraie connaissance des choses appellent également son attention (l’« élan vital » est rapproché du « qi », force vitale à caractère mystique au cœur de l’enseignement du Tao). En vue d’une renaissance spirituelle chinoise, Zhang s’appuie donc sur la métaphysique occidentale et il élabore une idéologie d’Etat.
De prime abord, le lien entre le marxisme-léninisme, fondement idéologique de la République Populaire de Chine (RPC), et les différentes synthèses confucéennes n’a rien d’évident (20). Lorsqu’il est constitué, le Parti communiste chinois se place à l’avant-garde de tous ceux qui veulent mettre à bas la « boutique Confucius » et brûler les Classiques. Lors de la Révolution culturelle, les Gardes rouges ont d’ailleurs commis de nombreuses destructions ; sans Taïwan et les Chines d’outre-mer, conservatoires de la tradition, l’héritage confucéen eût été perdu. La référence contemporaine des dirigeants chinois aux « valeurs confucéennes » est un emprunt à la cité-Etat de Singapour, lesdites « valeurs » servant de masque au néo-maoïsme de Pékin. Quant aux antécédents d’un tel type de pouvoir dans l’histoire chinoise, il faut plutôt les chercher dans le « légisme », école de pensée et doctrine de pouvoir quasi-inconnues du grand public occidental, mais de grande importance. Les « légistes » de la Chine antique se voulaient des réalistes au sens vulgaire du terme : des hommes non pas préoccupés par la quintessence des êtres et des choses, mais soucieux d’efficacité. Aucun principe, aucune tradition ne valait par eux-mêmes, le fonctionnement et le rendement prévalant sur toute norme. Shan Yang, Shen Buhai, Shen Dao et Han Fei sont les principaux représentants de cette « école des lois » aux IVe et IIIe siècles avant notre ère (21). Au cours de la Révolution culturelle, le légisme fut porté au pinacle, Mao Tsé-Toung étant considéré comme une hypostase du « Premier empereur » qui appliqua en son temps le programme de Han Fei. Dans le présent contexte, la référence aux « valeurs confucéennes » n’est que le masque d’un totalitarisme « high tech ».
9. « Historiquement chinoise, l’île de Taïwan est une province rebelle ». La domination chinoise sur Formose a été tardive, limitée et temporaire. Objet de déni à Pékin, Taïwan constitue un Etat aux solides assises historiques
Historiquement, Taïwan n’a que peu de liens avec l’histoire de la Chine, moins encore avec la République populaire de Chine (RPC) proclamée à Pékin, en 1949. L’île est peuplée d’Aborigènes malayo-polynésiens. Au XVIe siècle, les Portugais en prennent un temps possession et ils lui donnent le nom de « Formosa » (« La Belle »). Les Espagnols, puis les Hollandais, leur succèdent. Au cours de ces souverainetés successives, l’immigration chinoise commence à se développer. En 1684, la dynastie mandchoue qui gouverne la Chine la conquiert, mais elle contrôle uniquement la partie occidentale de Formose. Les tribus locales ont la réputation d’être constituées de féroces guerriers. A la suite de la guerre sino-japonaise (1895), le traité de Shimonoseki accorde Formose au Japon. De 1895 à 1945, l’île demeure sous la souveraineté de Tokyo, d’où une profonde empreinte culturelle. Ce demi-siècle au cours duquel Formose entre dans la modernité, le Japon tenant alors le rôle de passeur entre l’Asie et l’Occident, participe à la formation d’un sentiment national taïwanais, distinct de la Chine continentale. Du fait de la guerre civile entre nationalistes et communistes chinois, la réintégration par Tchang Kaï-chek de Formose, après la capitulation du Japon, n’a pu effacer l’histoire antérieure de l’île (22).
Ensuite, l’histoire de Formose est celle de l’opposition à la RPC. En 1949, les armées de Tchang Kaï-chek et deux millions de continentaux évacuent la Chine continentale pour se réfugier dans l’île et y perpétuer la République de Chine. Jusqu’en 1971, elle est considérée comme la seule Chine officielle et dispose d’un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Sous la protection militaire des Etats-Unis malgré la reconnaissance diplomatique de la RPC (1979), la dictature modernisatrice de Tchang Kaï-chek conduit une efficace politique de développement. Après sa disparition (1975), le régime se libéralise progressivement, montrant ainsi que la « démocratie de marché » peut s’implanter à l’extérieur de la sphère occidentale. Avec le temps, une part grandissante des Taïwanais prend ses distances avec la théorie d’« une seule Chine » et songe à une indépendance de jure. En mars 2005, Pékin adopte une « loi anti-sécession » qui fait d’une éventuelle déclaration d’indépendance un casus belli. Année après année, la RPC se donne les moyens de contrer la protection militaire américaine. En dépit du caractère despotique de la RPC et du fait que Taïwan, qui n’a appartenu à la sphère chinoise que temporairement et partiellement, suive son propre chemin sans pour autant franchir le Rubicon, l’Union européenne et ses Etats membres misent sur la perpétuation du statu quo. La constitution d’une kyrielle d’Etats clients en Europe va aussi en ce sens. Toutefois, l’ouverture d’une nouvelle guerre froide avec Pékin pourrait renouveler la situation (23).
10. « La « Méditerranée asiatique » (mer de Chine du Sud) relève de la souveraineté chinoise ». Ce sont les revendications françaises sur les Spratleys et les Paracels, à l’époque de l’Indochine coloniale, qui ont induit celles de la Chine nationaliste puis de la Chine communiste
En matière de liberté de navigation, Pékin ne cache pas ses ambitions et, au moyen d’un colossal programme de construction navale, se dote des moyens de conduire une politique de domination. Ainsi la Chine populaire considère-t-elle que ses eaux territoriales s’étendent jusqu’à quinze milles nautiques de ses côtes (douze selon le droit de la mer) et elle refuse le régime normal de « transit inoffensif » pour les bâtiments d’autres marines de guerre que la sienne. Au-delà de ces atteintes au droit international, Pékin prétend que la quasi-totalité de mer de Chine méridionale lui appartient en propre. Il faut ici rappeler que cette « Méditerranée asiatique » est un espace plus vaste encore que la mer Méditerranée (2,5 millions de km²). Imagine-t-on un jour l’Union européenne en tant que telle, avec l’accord de ses Etats membres, proclamer que la Méditerranée constitue à nouveau une « Mare nostrum », excluant ainsi les riverains méridionaux et orientaux de tout droit sur cette mer ? C’est pourtant ce que Pékin fait, au moyen d’une politique de poldérisation de rochers et de récifs (certains sont transformés en bases navales et aériennes), d’intimidation des pays voisins et d’irrespect du droit : la Cour permanente d’arbitrage de La Haye a en effet repoussé les revendications de la Chine populaire sur ces espaces maritimes (12 juillet 2016).
Pour justifier ses ambitions sur la « Méditerranée asiatique », Pékin manipule différentes arguties historiques et se réfère à une « ligne en neuf traits ». Il s’agit d’une carte, dessinée en 1947, qui prétend reproduire les frontières du système tributaire chinois, au-delà de la Chine proprement dite. Ce document inclut des îles et archipels sur lesquels l’Empire du Milieu n’a jamais exercé sa suzeraineté. Il aura fallu en fait que la France et le Japon, dans l’entre-deux-guerres, se disputent les Paracels pour que la République de Chine les revendique (1932). Après avoir affirmé alors que la limite méridionale de sa souveraineté s’appuyait sur cet archipel, le gouvernement chinois a ensuite « découvert » les îles Spratleys après que la France y ait étendu sa souveraineté (1933). Formé en France auprès de Jean Brunhes et d’Emmanuel de Martonne, entre 1926 et 1928, le géographe chinois Hu Huanyong tient un rôle essentiel dans ces revendications (24). Devenu conseiller du gouvernement de Nankin, il publie dans la Revue diplomatique chinoise un article intitulé : « La France et le Japon convoitent les îles de la Mer méridionale » (1934). La publication appelle l’attention du gouvernement chinois. Depuis cette époque, les récifs et archipels de la « Méditerranée asiatique » sont considérés à Nankin, puis à Pékin, comme appartenant de toute éternité à la Chine (25). Le passage à l’acte envers et contre tout respect du droit et relation de bon voisinage préfigurait une politique agressive d’ensemble. Une réalité autrement plus prégnante que les propos lénifiants ou abscons greffés sur l’antique concept de « Tianxia » (« Tout sous le ciel »).
Notes •
(1) Les Tokhariens se désignaient sous les noms d’Arśi et Kuči. Les premiers Tokhariens seraient originaires de la culture d’Afanasievo (Sibérie méridionale, 3200-2500 av. J.-C.) et ils se seraient déplacés vers l’Orient avant les Indo-Iraniens. Voir Bernard Sergent, « Les Sères sont les soi-disant « Tokhariens », c’est-à-dire les authentiques Arśi-Kuči », Dialogues d’histoire ancienne, Année 1998 Volume 24, Numéro 24-1.
(2) Depuis l’entre-deux-guerres, de nombreuses traces d’un peuplement de type caucasien, clair de complexion, et des centaines de momies ont été trouvées sur les pourtours du Taklamakan, dans le bassin du Tarim (actuel Sin-Kiang). Les « momies blanches du Taklamakan », qu’il faut rapprocher des Tokharien, vivaient à l’époque des Xia, dynastie originelle chinoise dont l’existence reste à prouver. Le pouvoir chinois se montre d’autant plus rétif à ces recherches que les nationalistes ouïghours veulent voir en ces momies leurs lointains ancêtres.
(3) Dans le chapitre VIII des Analectes, Confucius rend hommage aux Sages Roi de la mythologie : Yao, Shun et Yu (troisième millénaire avant J.-C. selon le comput traditionnel). Ce dernier est le fondateur de la première dynastie légendaire des Xia (une dynastie tokharienne ?). Vient ensuite la dynastie des Shang (2205-1767 av. J.-C.). C’est surtout aux souverains de la dynastie des Zhou que Confucius se réfère comme exemples de vertu. Ancêtres de la dynastie, le roi Wen et son fils, Wu, ont détrôné par la force le dernier souverain des Shang. Cette prise du pouvoir par la force est à l’origine de la théorie du Mandat Céleste (Analectes, Livre XX).
(4) Voir Jean Lévi, La Chine en guerre, Arkhé, 2018.
(5) L’art de la guerre et six autres textes de la pensée politique et stratégique chinoise sont rassemblés en canon par Shenzong, le sixième empereur de la dynastie Song (960-1279). Une édition de l’Art de la guerre a été retrouvée dans une tombe datant de la dynastie Han (206 av. J.-C.-220 ap. J.-C.). En poste à la mission de Pékin, le jésuite Joseph Amiot paraphrase une traduction commentée mandchoue de l’Art de la guerre, ce qui porte ce traité à la connaissance de l’Europe cultivée (1772).
(6) Les Mandchous sont les héritiers des Jürchen, une ethnie toungouze (les Toungouzes sont un peuple sibérien parlant une langue ouralo-altaïque). Alors qu’ils conquièrent la Chine, les Jürchen prennent le nom de « Manchous » qui signifie « grands, forts ». Les souverains mandchous ont conservé leur identité ethnique, leur langue et leur système d’écriture, dérivé de l’alphabet araméen par l’entremise des Sogdiens et des Ouïghours.
(7) Il importe de rappeler l’origine étrangère des dynastes Yuan et Qing, respectivement mongols et mandchous, ce qui heurte une forme d’ethnisme Han, sectes et sociétés secrètes (le « Lotus blanc ») animant de multiples révoltes et guerres intérieures.
(8) Edward N. Luttwak, La montée en puissance de la Chine et la logique de la stratégie, Odile Jacob, 2012, p. 92.
(9) L’appellation d’empire lui est conférée par les Occidentaux, à la recherche d’un terme adéquat pour dénommer les formations politiques prémodernes qu’ils rencontrent dans leur entreprise d’arraisonnement du monde, des Grandes Découvertes au premier tiers du XXe siècle. Le « Pays du milieu » (Zhongguo), ou encore la « Fleur du milieu » (Zhonguua), i.e. la Chine, est au cœur d’une constellation de royaumes, principautés et peuples tributaires, l’ensemble formant un système géopolitique de type centre/périphérie. Originellement, « Milieu » renvoie à la Plaine centrale (bassin du fleuve Jaune), là où l’ethnogenèse des Han s’est produite. La tradition chinoise en fait le centre du « Céleste Empire ». Toutefois, les recherches archéologiques des dernières décennies montrent que l’espace géographique dans lequel la civilisation chinoise s’enracine originellement est plus au nord, dans une vaste région liée aux dynamiques de l’Asie centrale et septentrionale (Sibérie).
(10) Officiellement institué en 1760 par un édit impérial, le Co-hong était une guilde de marchands auxquels le monopole du commerce avec leurs homologues occidentaux était confié. Les marchands occidentaux étaient quant à eux relégués à l’extérieur de la ville, dans un espace restreint et pour une durée limitée.
(11) Sur l’ensemble de cette question, voir Xavier Paulès, L’opium : une passion chinoise, 1750-1950, Payot, 2011.
(12) S’il stipule l’abolition du Co-hong et l’ouverture de quatre ports, en sus de Canton, au commerce international, le traité de Nankin (1842) ne mentionne d’ailleurs pas l’opium. En revanche, ce trafic est légalisé par la convention de Pékin (1860), à l’issue de la seconde guerre de l’Opium.
(13) En 1860, le Britannique Charles Gordon (1833-1885), avec l’assentiment de son gouvernement, se met au service de la dynastie Qing afin de lutter contre les Taiping. Il contribue à la réorganisation de l’armée, dégage la ville de Shanghaï, libère Suzhou et d’autres villes. Charles Gordon est dès lors appelé « le Chinois » Egalement surnommé « Gordon Pacha » après avoir lutté contre le trafic d’esclaves au Soudan (1874-1879), il meurt à Khartoum, le 26 janvier 1885, lors de la prise de la ville par le Mahdi et les tribus esclavagistes du Soudan qui soutenaient ce « messie » musulman (voir la « guerre des Mahdistes », 1881-1899). Parallèlement, de grands fonctionnaires provinciaux, des chefs militaires et des « hommes nouveaux » s’affirment pendant cette période. Ils soutiennent ensuite le mouvement des réformes, s’opposant ainsi aux coteries et clans réactionnaires (stricto sensu) de la Cour mandchoue.
(14) L’expression renvoie à ce qu’Henry Kissinger nomme « le programme de Wei Yuan ». Mandarin lié à Lin Zexu, le fonctionnaire qui avait fait bruler les caisses d’opium à Canton (1839), Wei Yuan est l’auteur d’un traité de géographie visant à développer une diplomatie rénovée, au-delà des pays tributaires voisins. Il propose de s’accrocher au traité de Nankin tout en instaurant des relations avec des pays susceptibles de contrebalancer le poids de l’Angleterre. Sont ainsi identifiés la France et les Etats-Unis d’Amérique. Le « programme de Wei Yuan » se heurte au peu de connaissance que la Chine a de l’environnement international lointain, ce qui contrarie l’idée d’une politique mondiale active. Voir Henry Kissinger, De la Chine, Fayard, 2011, p. 78-81.
(15) Il s’agit d’une révolte estudiantine à Pékin alors que la Conférence de la Paix, réunie à Paris depuis janvier 1919, négocie le traité de Versailles et le sort des possessions allemandes en Chine et dans le Pacifique. A l’information selon laquelle le Japon conserverait Qingdao et la péninsule du Shandong, pris à l’Allemagne au début de la Première Guerre mondiale, les étudiants de l’Université de Pékin manifestent. Ce mouvement renforce le nationalisme chinois et donne un tour plus radical encore aux réformes des débuts de la république (voir le slogan « A bas la boutique Confucius » et ses conséquences dans l’ordre de la culture et du savoir). Dans le prolongement de cette vague qui parcourt les grandes villes chinoises, le Parti communiste chinois est fondé à Shanghaï (1921).
(16) Pour prix de ses bons offices lors de la deuxième guerre de l’Opium, l’Empire russe obtient de la Chine la cession de la Mandchourie extérieure, ce qui correspond à l’actuel Extrême-Orient russe (1858-1860). Est fondé le port de Vladivostok. A l’issue de la guerre de 1895, le Japon dispose de l’île de Formose, étend son influence à la Corée et ses dirigeants ont des vues sur la Mandchourie. Après une guerre victorieuse contre la Russie (1904-1905), la Mandchourie entre effectivement dans leur zone d’influence. Le projet d’un Grand Japon, nouvelle puissance hégémonique au centre d’une sphère asiatique est dès lors envisagé. En d’autres termes, le Japon entend prendre la place historique de la Chine.
(17) L’empereur Guangxu règne de 1875 à 1908. Longtemps dans l’ombre de l’impératrice douairière Cixi (Tseu-Hi), il cherche alors s’émanciper. Une « révolution de palais » conduite par ladite impératrice aboutit à la marginalisation de Guangxu, ses conseillers et ministres réformateurs étant pour la plupart exécutés.
(18) Voir Thomas Rawski, Economic Growth in Prewar China, University of California Press, 1989.
(19) Voir Sherman Cochran, Big Business in China: Sino-Foreign Rivalry in the Cigarette Industry, 1890-1930, Harvard University Press, 1980.
(20) Notons à ce propos l’influence des écrits taoïstes sur diverses formes chinoises d’anarcho-communisme à caractère rustique. Quant au marxisme, il n’est connu que par bribes au début du XXe siècle, par le truchement du Japon où quelques textes sont pour la première fois traduits en chinois. C’est avant tout le programme anti-impérialiste du coup de force bolchevik qui suscite l’enthousiasme de certains étudiants chinois. Fondateur du Parti communiste chinois (PCC), Chen Duxiu (1879-1942) doute progressivement de la vérité scientifique du matérialisme historique. Expulsé du PCC en 1929, il se rallie au trotskysme, puis est emprisonné sous le régime de Tchang Kaï-chek. Libéré en 1937, il se voue ensuite à l’étude de la langue chinoise. Autre personnalité du communisme chinois, Li Dazhao (1889-1927) tente véritablement de siniser le marxisme ; il inspire Mao Tsé-Toung qui lui empruntera le thème de l’importance de la paysannerie dans le processus révolutionnaire. Quant à ce dernier, il se contente pour l’essentiel de paraphraser les documents de la propagande soviétique des années 1930. L’importance de Mao Tsé-Toung n’est pas théorique, mais politique et militaire, en tant que chef du communisme chinois à partir de la « Longue marche » (1934-1935), ce désastre militaire présenté comme moment de gloire.
(21) « Le légisme, explique Jean Levi, connut un destin paradoxal, puisque son succès causera sa perte. Au moment où il triomphe dans les faits, il disparaît du discours. Mieux, le signe de son triomphe est le mutisme dont on l’entoure. Inscrites dans la réalité de l’exercice du pouvoir, et irriguant la pratique administrative jusque dans les moindres dispositions du code pénal, les thèses de Han Fei ne seront plus jamais matière à discussion ou à réélaboration avant le XXe siècle, à quelques rares exceptions près ». Voir Jean Lévi, « La doctrine du légisme en Chine, à l’origine des théories du pouvoir fort », Clio, juin 2003.
(22) La République de Chine comprend aujourd’hui l’île de Taïwan, les Pescadores, les archipels Quemoy et Matsu ainsi que Taiping. De part et d’autre du détroit de Formose, la disproportion est énorme : 36 000 km² et 23 millions d’habitants pour la République de Chine ; 9,6 millions km² et 1 375 milliards d’habitants pour la RPC.
(23) Jean-Sylvestre Mongrenier et Laurent Amelot, Pourquoi faut-il soutenir l’île-État de Taïwan ?, Institut Thomas More, Note d’actualité 66, avril 2020, disponible ici.
(24) Le géographe Hu Huanyong est surtout connu en Occident pour avoir identifié et tracé la diagonale qui sépare la Chine peuplée de l’Est de la Chine aride et sous-peuplée de l’Ouest (la « ligne de démarcation géo-démographique » Heihe-Tenchong), en 1935.
(25) Voir Emmanuel Dubois de Prisque, « La cartographie en Chine du rêve chinois à la réalité géopolitique », Outre-Terre, n°38, 2014/1.
Téléchargez la publication
L’auteur

Jean-Sylvestre Mongrenier est chercheur associé à l’Institut Thomas More. Titulaire d’une licence d’histoire-géographie, d’une maîtrise de sciences politiques, d’un Master en géographie-géopolitique et docteur en géopolitique, il est professeur agrégé d’Histoire-Géographie et chercheur à l’Institut Français de Géopolitique (Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis). Il est conférencier à l’IHEDN (Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, Paris), dont il est ancien auditeur et où il a reçu le Prix Scientifique 2007 pour sa thèse sur « Les enjeux géopolitiques du projet français de défense européenne ». Officier de réserve de la Marine nationale, il est rattaché au Centre d’Enseignement Supérieur de la Marine (CESM), à l’École Militaire. Il est notamment l’auteur de Géopolitique de l’Europe (PUF, « Que sais-je ? », 2020) • |