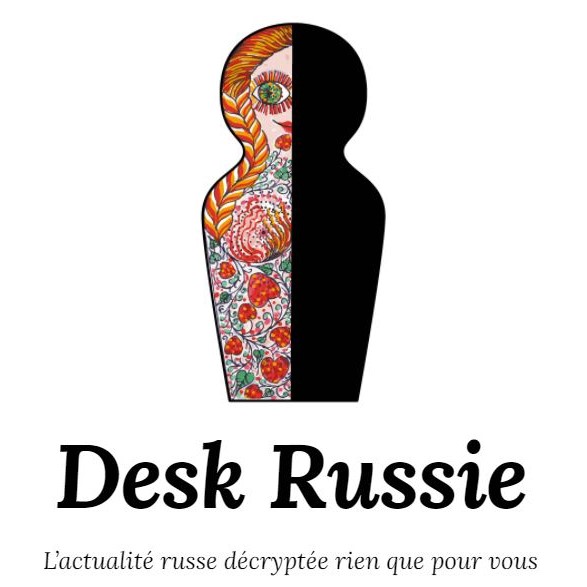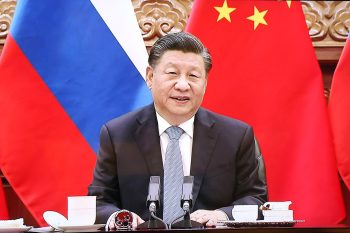
12 mai 2024 • Analyse •
Accueilli à Paris les 6 et 7 mai, Xi Jinping, le nouveau Grand Timonier chinois, a poursuivi son itinéraire vers la Serbie et la Hongrie, deux pays dont les dirigeants sont acquis à la thèse d’un grand basculement vers l’Asie. Plus tard dans le mois, il recevra Vladimir Poutine. En Europe, les esprits admettent enfin la réalité et la profondeur de l’axe stratégique Pékin-Moscou, moteur des dynamiques anti-occidentales et du ressentiment impérialiste. Sans le soutien multiforme de Pékin, la Russie-Eurasie de Vladimir Poutine serait en mauvaise posture sur le front ukrainien. Analyse pour Desk Russie.
Plutôt que cultiver leur différence diplomatique sur la question chinoise, il importe donc que Paris et Berlin tirent les conclusions des faits observables : la Chine populaire est une puissance hostile qui approvisionne et finance la guerre russe en Ukraine, doublée d’une guerre indirecte contre les États membres de l’OTAN et de l’Union européenne. Simultanément, Pékin cherche à instrumentaliser l’Europe contre les États-Unis (1). A contrario, l’unité occidentale et la vitalité des solidarités transatlantiques exigent la formation d’un front diplomatique commun à l’encontre de la Chine populaire. Cela commence dans l’ordre des représentations, le discours géopolitique et les arguties historicisantes de Pékin devant être passés au crible. De fait, un certain nombre de rectifications s’imposent.
Sur la puissance historique de la Chine et son prétendu pacifisme
La fascination de l’Europe classique, puis de certains philosophes des Lumières, pour la Chine, la diffusion plus tardive des écrits de Sun Tzu (« vaincre sans combattre ») et l’idéologie victimaire du nationalisme chinois moderne ont amplement véhiculé l’idée d’une Chine fondamentalement pacifique. Tout au plus aurait-elle été contrainte à se défendre par les armes. Dans le même registre, voici peu encore, certains expliquaient que la Chine n’étant pas universaliste, il ne fallait pas redouter sa montée en puissance. En opposition à cette thèse d’un monde chinois équilibré, de longue date pacifique, les travaux archéologiques ont depuis révélé le caractère sanguinaire des guerres menées sous la dynastie Zhou (1121-256 av. J.-C.). Par la suite, l’époque « Printemps et Automnes » (722-481 av. J.-C.) et celle des « Royaumes Combattants » furent marquées par des conflits hyperboliques entre des principautés rivales, rois et princes militarisant la société (2). Sous cet aspect, les théories stratégiques de Sun Tzu (3) ne rendent pas compte de la réalité historique : jeux diplomatiques, espionnage et subversion de type intra-culturel, ruses et stratagèmes n’excluaient pas le recours à la force armée (loin s’en faut).
C’est par la guerre que le roi Zheng unifie l’espace chinois (221 av. J.-C.). Dès lors, il porte le titre de « Qin Shi Huang » (le « Premier Empereur »). Découvert à Xian, en 1974, le tombeau de Qin Shi Huang, avec les 7 000 cavaliers et fantassins de terre cuite qu’il contient, donne idée de sa puissance. Depuis le bassin du fleuve Jaune, noyau géohistorique des Han, les conquêtes territoriales se font en aval et dans les plaines septentrionales. Elles sont ensuite tournées vers le sud, en Asie des Moussons. Parallèlement, les conquêtes se portent vers la Haute-Asie et le Turkestan, espaces de confrontation avec les peuples tibéto-birmans et turciques ; il faudra attendre la dynastie Qing (1644-1912) pour que l’empire du Milieu conquière effectivement ces espaces. Quant aux peuples de la périphérie, ils sont réputés barbares (yi), et réduits à l’état de tributaires (la tradition chinoise distingue les « Barbares cuits » des « crus », ces derniers étant réputés inassimilables). Dès ses origines, l’histoire de l’État-civilisation chinois s’inscrit dans le cadre de frontières mobiles et conquérantes. Notons par ailleurs que les souverains d’ethnie Han furent régulièrement vaincus par des ennemis inférieurs en nombre. Ce sont leurs vainqueurs, notamment la dynastie mandchoue des Qing, qui repoussèrent les frontières de l’empire dont ils avaient fait la conquête (4).
Lors de ses phases unitaires, l’empire du Milieu a effectivement imposé sa primauté en Asie de l’Est, sur ses contours et dans les profondeurs du continent (5). Partant de ce fait indéniable, d’aucuns expliquent que l’hypothétique accès de la Chine contemporaine au premier rang mondial, voire sa transformation en « superpuissance », ne serait que le retour du même. Initiés par Angus Maddison, les travaux de statistiques historiques de longue durée montrent qu’en 1700, la Chine représentait 23% de la population humaine et 22% de la production mondiale de richesses. Si l’on extrapole à partir des données macroéconomiques, la République populaire de Chine ne ferait donc que retrouver sa place de première puissance mondiale. Cependant, on confond ici l’effet de taille et la puissance, définie comme la capacité à imposer sa volonté à d’autres acteurs internationaux. La population chinoise de l’époque était essentiellement composée de paysans réduits à l’autoconsommation. Le surplus dégagé n’était pas suffisant pour financer une grande politique de puissance. Déjà supérieure à celle de la Chine dans le Nord-Ouest européen vers 1500, la richesse par habitant était moitié plus importante un siècle plus tard. Et si l’Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, au moment où le roi George III envoie Lord Macartney en ambassade, pesait moins que l’empire du Milieu, l’innovation et le dynamisme étaient de son côté : elle était destinée à l’emporter.
En d’autres termes, la pesée globale d’un ensemble humain n’est pas la puissance, et la primauté historique de la Chine s’exerçait sur le seul théâtre asiatique (une « superpuissance » régionale). Quant à la thèse selon laquelle l’empire du Milieu était le moteur de la mondialisation, elle n’a guère de sens. S’il est loisible de spéculer sur ce que la menée à terme des expéditions de Zheng He aurait pu produire (sept expéditions de 1405 à 1433), il s’agit là d’un exercice d’uchronie. Les Grandes Découvertes, la première circumnavigation et la traversée en tous sens de l’océan Pacifique sont le fait des nations occidentales. Certes, la découverte de la civilisation chinoise et l’attraction de ses produits étaient de puissants mobiles. Il reste que le commerce avec la Chine ne représentait qu’une fraction réduite de celui réalisé dans l’océan Atlantique, cet axe géopolitique de l’Occident moderne. Si l’on prend l’exemple des États-Unis au milieu du XIXe siècle, la Chine représentait les trois quarts du commerce réalisé dans le Pacifique, mais moins d’un dixième du total des échanges commerciaux américains. En rupture avec la thèse développée par certains historiens chinois, reprise par les tenants d’une « histoire interconnectée » qui dénie le rôle historique de l’Occident, il est faux d’affirmer que la richesse des marchands du Co-hong finançait le développement économique des États-Unis (6). Il faut ici souligner le postulat arbitrairement anti-occidental de l’histoire dite « globale » ou « interconnectée ».
Sur le syndrome victimaire de la Chine
Les guerres de l’Opium, explique-t-on, ruinèrent la Chine et discréditèrent moralement l’Occident. De prime abord, il importe de rappeler le contexte historique. Lorsque les deux guerres de l’Opium se produisirent (1839-1842 ; 1856-1860), l’Empire chinois était déjà engagé dans une spirale dépressive et, plus largement, un déclin à plusieurs dimensions. D’ethnie mandchoue, la dynastie Qing avait atteint son apogée au XVIIIe siècle. Si la Chine était distancée par la « révolution scientifique » du XVIIe siècle, elle atteignait alors sa plus grande extension territoriale, non point par subjugation culturelle, mais par le fer et le feu. Après un âge d’or (une « Pax Mandchourica »), la mort de l’Empereur Qianlong, en 1795, constitue un repère commode. La croissance démographique dépassait alors le potentiel économique du pays ainsi que la capacité d’encadrement de l’appareil d’État. Dans la grande dépression qui s’abattit sur la Chine au cours de la première moitié du XIXe siècle, les facteurs endogènes étaient les plus importants : famines et déforestation, sous-entretien des aménagements hydrauliques, gonflement de la population errante, crise du bimétallisme argent/cuivre ainsi que révoltes suscitées par la secte du Lotus Blanc qui mirent à sec le trésor impérial (1796-1804). Quant à l’opium, il était consommé et importé avant que des marchands-contrebandiers, britanniques mais pas exclusivement, y virent le produit qui permettrait de rééquilibrer les échanges avec la Chine (les importations de thé, de soie et de porcelaines étaient réglées en métal argent). Une fois la marchandise acheminée jusqu’aux littoraux, c’étaient des contrebandiers chinois qui, avec la protection de mandarins corrompus, contrôlaient ce commerce (7).
L’interdiction impériale de ces importations visait non pas à endiguer un fléau sanitaire, mais à empêcher les sorties d’argent métal. Si l’affaire aboutit à une guerre avec l’Angleterre, les enjeux étaient plus larges que le seul opium : la liberté du commerce, l’instauration de relations diplomatiques, la liberté religieuse (8). Significativement, les sources officielles chinoises ne parlent que de « troubles de l’opium ». Autrement plus meurtrières et coûteuses furent les terribles guerres et insurrections intérieures : révolte des Taiping dans la basse vallée du fleuve Bleu (1850-1864), des Nian au Nord (1853-1868), des Turbans rouges dans la région de Canton (1854). S’y ajoutèrent des révoltes de Hui au Yunnan (1855), puis dans le Nord-Ouest (1862-1863 et 1876), des épisodes de guerre entre les Hakka (des Han du Nord ayant migré en Chine méridionale) et les populations locales. Ces conflits et leur répression firent des dizaines de millions de morts. Il fallut l’appui des puissances occidentales et l’affirmation d’une élite politique et militaire provinciale pour que la dynastie Qing surmonte l’épreuve (9). La démographie chinoise subit les conséquences de ces pertes et les vides ne furent que progressivement comblés. La zone centrale de l’empire, c’est-à-dire la plus peuplée et la plus riche, était ravagée. La nécessité de restaurer l’économie rurale eut pour effet d’aggraver les charges sur le commerce et l’artisanat : de lourdes taxes sur la circulation cloisonnaient l’espace, ce qui pesait sur les efforts de modernisation. La Chine devint alors un État centré sur l’agriculture.
C’est dans ce contexte que la Chine se vit imposer d’« injustes traités inégaux ». À l’aune de l’histoire universelle, rien de nouveau : induit en tentation, le plus fort impose sa loi au plus faible. Durant de longs siècles, les « traités inégaux » furent la règle entre l’empire du Milieu et ses périphéries tributaires, sans revenir sur les conquêtes et les dommages que ces dernières causèrent. Qui s’en indigne aujourd’hui à Pékin ? Avec les guerres de l’Opium, le cours des événements fut désormais autre : History as usual. L’analyse doit cependant aller plus loin que la simple religion du fait accompli. Il importe de comprendre que la cosmologie impériale mettait en scène des acteurs n’ayant pas le même statut ontologique. Au cœur d’une constellation de royaumes et de principautés tributaires, l’empire du Milieu occupait une position éminente et il prétendait à une forme de monarchie universelle (cf. le concept de Tianxa : « tout sous le ciel »). À l’inverse, l’Angleterre et les puissances occidentales entendaient traiter avec la Chine sur un pied d’égalité, sur le modèle du système westphalien. Les représentants diplomatiques que ces nations dépêchaient en Chine refusaient de se prosterner devant l’Empereur (le kowtow) et elles voulaient pouvoir ouvrir des ambassades permanentes à Pékin.
Si le traité de Nankin (1842) tient effectivement compte du rapport des forces issu de la première guerre de l’Opium, c’est surtout en raison de l’égalité de principe des parties signataires qu’il a traumatisé la conscience impériale chinoise. Dans la période qui suivit, les autorités chinoises s’appuyèrent pourtant sur les clauses de ce traité afin d’endiguer la pression anglaise. Conformément à l’antique stratégie qui consiste à « utiliser les barbares contre les barbares » (10), elles proposèrent d’elles-mêmes aux Américains et à d’autres nations occidentales de jouir des mêmes avantages. Après le Mouvement du 4 mai 1919 (11), nationalistes et communistes chinois réinterprétèrent cette période : c’est alors que le thème anachronique des « traités inégaux » s’imposa. Il est vrai cependant que le statut d’extraterritorialité des sujets occidentaux instaurait des relations sans équivalent dans le système westphalien. Encore est-il bon de savoir que l’extraterritorialité était de coutume en Chine : le droit chinois étant sacré, il ne pouvait être appliqué à des « barbares ». Les Occidentaux surent manœuvrer pour exploiter au mieux l’exclusivisme traditionnel des Chinois, l’institutionnalisation de l’extraterritorialité étant complétée par un système de territoires à bail (la méthode fut reproduite par les Qing en Corée, de longue date satellisée). À la différence de la Russie et du Japon, les puissances occidentales ne conçurent cependant pas de vastes programmes de conquêtes territoriales, ni ne songèrent à s’approprier la cosmologie impériale chinoise (le Japon de l’ère Meiji se voyait en nouvel empire du Milieu) (12).
Sur les revendications territoriales chinoises en Asie-Pacifique
On sait que Pékin considère l’île-État de Taïwan comme une province rebelle. Historiquement, Taïwan n’a que peu de liens avec l’histoire de la Chine, moins encore avec la République populaire de Chine (RPC) proclamée en 1949. L’île était alors peuplée d’Aborigènes malayo-polynésiens. Au XVIe siècle, les Portugais en prirent possession et lui donnèrent le nom de « Formosa » ( « La Belle »). Les Espagnols, puis les Hollandais, leur succédèrent. Au fil de ces souverainetés successives, l’immigration chinoise commença à se développer. En 1684, la dynastie mandchoue conquit Formose mais elle n’en contrôlait que la partie occidentale ; les tribus locales avaient la réputation d’être constituées de féroces guerriers. À la suite de la guerre sino-japonaise (1895), le traité de Shimonoseki accorda Formose au Japon. De 1895 à 1945, l’île demeura sous la souveraineté de Tokyo, d’où une profonde empreinte culturelle. Ce demi-siècle au cours duquel Formose entra dans la modernité, le Japon tenant alors le rôle de passeur entre l’Asie et l’Occident (13), contribua à la formation d’un sentiment national taïwanais, distinct de la Chine continentale. Du fait de la guerre civile entre nationalistes et communistes chinois, la reprise par Tchang Kaï-chek de Formose, après la capitulation du Japon, ne put effacer l’histoire antérieure de l’île (14).
Depuis, l’histoire de Formose est celle de l’opposition à la République populaire de Chine. En 1949, les armées de Tchang Kaï-chek et deux millions de continentaux évacuèrent la Chine continentale pour se réfugier dans l’île et y perpétuer la République de Chine. Jusqu’en 1971, celle-ci était considérée comme la seule Chine officielle et disposait d’un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Sous la protection militaire des États-Unis, malgré la reconnaissance diplomatique de la République populaire de Chine (1979), la dictature modernisatrice de Tchang Kaï-chek conduisit une efficace politique de développement. Après sa disparition (1975), le régime se libéralisa progressivement, montrant ainsi que la « démocratie de marché » peut s’implanter à l’extérieur de la sphère occidentale. Avec le temps, une part grandissante des Taïwanais prit ses distances avec la théorie d’« une seule Chine » et songea à une indépendance de jure. En mars 2005, Pékin adoptait une « loi anti-sécession » qui fait d’une éventuelle déclaration d’indépendance un casus belli. Depuis, la République populaire de Chine se donne les moyens de contrer la protection militaire américaine. En dépit du caractère despotique de la Chine populaire et du fait que Taïwan, qui n’a appartenu à la sphère chinoise que temporairement et partiellement, suive son propre chemin (sans pour autant franchir le Rubicon), l’Union européenne et ses États membres misent sur la perpétuation du statu quo. L’appui apporté par Pékin à la Russie, dans la guerre en Ukraine, sur fond de conflit latent entre l’axe Moscou-Pékin-Téhéran et l’Occident, devrait faire évoluer la situation (15). D’autant plus que la Chine populaire n’a en rien aidé à résoudre la crise nucléaire nord-coréenne.
Au-delà de Taïwan, les vues chinoises portent sur la « Méditerranée asiatique » (la mer de Chine du Sud). En matière de liberté de navigation, Pékin ne cache pas ses ambitions et, au moyen d’un colossal programme de construction navale, se dote des moyens de conduire une politique de domination. Ainsi la Chine populaire considère-t-elle que ses eaux territoriales s’étendent jusqu’à quinze milles nautiques de ses côtes (douze selon le droit de la mer) et elle refuse le régime normal de « transit inoffensif » pour les bâtiments d’autres marines de guerre que la sienne. Au-delà de ces atteintes au droit international, Pékin prétend que la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud lui appartient en propre. Il faut ici rappeler que cette « Méditerranée asiatique » est un espace plus vaste encore que la mer Méditerranée (2,5 millions de km²). Imagine-t-on un jour l’Union européenne en tant que telle, avec l’accord de ses États membres, proclamer que la mer Méditerranée constitue de nouveau une « Mare nostrum », excluant ainsi les riverains méridionaux et orientaux de tout droit sur cet espace maritime ? C’est pourtant ce que Pékin fait, au moyen d’une politique de poldérisation de rochers et de récifs (certains sont transformés en bases navales et aériennes), d’intimidation des pays voisins et de non-respect du droit : la Cour permanente d’arbitrage de La Haye a en effet repoussé les revendications de la Chine populaire sur ces espaces maritimes (12 juillet 2016).
Pour justifier ses ambitions sur la « Méditerranée asiatique », Pékin manipule différentes arguties historiques et se réfère à une « ligne en neuf traits ». Il s’agit d’une carte, dessinée en 1947, qui prétend reproduire les frontières du système tributaire chinois, au-delà de la Chine proprement dite. Ce document inclut des îles et archipels sur lesquels l’empire du Milieu n’a jamais exercé sa suzeraineté. Il aura fallu que la France et le Japon, dans l’entre-deux-guerres, se disputent les Paracels pour que la République de Chine les revendique (1932). Après avoir affirmé que la limite méridionale de sa souveraineté s’appuyait sur cet archipel, le gouvernement chinois « découvrit » les îles Spratleys, après que la France y eut étendu sa souveraineté (1933). Formé en France auprès de Jean Brunhes et d’Emmanuel de Martonne, entre 1926 et 1928, le géographe chinois Hu Huanyong tint un rôle essentiel dans ces revendications (16). Devenu conseiller du gouvernement de Nankin, il publia dans la Revue diplomatique chinoise un article intitulé : « La France et le Japon convoitent les îles de la Mer méridionale « (1934). La publication appela l’attention du gouvernement chinois. Depuis cette époque, les récifs et archipels de la « Méditerranée asiatique » sont considérés à Nankin, puis à Pékin, comme appartenant de toute éternité à la Chine populaire (17). Le passage à l’acte dans la région, envers et contre tout respect du droit international et relation de bon voisinage, préfigurait une politique agressive d’ensemble.
En guise de conclusion
En somme, la réalité historique et celle des agissements de la Chine populaire contemporaine, placée sous la coupe de Xi Jinping et d’une clique néo-maoïste, sont autrement plus parlantes que les strophes de Victor Hugo à propos de l’incendie du Palais d’été, brûlé lors de la seconde guerre de l’Opium, ou les propos lénifiants d’intellectuels chinois greffés sur l’antique concept de « Tianxia » (« Tout sous le ciel »), concept présenté comme la solution universelle aux maux de l’humanité. Le discours manié à Pékin ne saurait en effet dissimuler l’agressivité de la superpuissance chinoise et le soutien résolu qu’elle apporte à la Russie-Eurasie. L’affaire ne se limite pas à des litiges commerciaux, à des questions de dumping et de voitures électriques ; il est crucial que les Occidentaux ne se divisent pas sur la question chinoise et l’attitude à adopter.
Les diverses illusions des dernières années – « Nixon in reverse » pour certains, « reset » sino-européen pour d’autres –, doivent être dissipées. L’important est de comprendre que Pékin et Moscou s’appuient réciproquement et s’accordent sur l’objectif de destruction de ce qu’ils appellent l’hégémonie occidentale. Il ne s’agit pas d’une convergence temporaire, provoquée par la guerre en Ukraine, mais d’un mouvement géopolitique long, qui commence dès la fin de la « guerre de Cinquante Ans » (la première guerre froide) ; feu Evgueni Primakov aura été le concepteur de cette coalition dite « anti-hégémonique ». C’est en conjuguant leurs efforts, de l’Ukraine au détroit de Taïwan, en se partageant le fardeau de la défense (voir le thème du « burden-sharing », que les Occidentaux pourront faire face au « cauchemar de MacKinder » : un bloc de puissance eurasiatique qui ferait de l’Europe un « petit cap » de l’Asie et isolerait l’Amérique.
Notes •
(1) Laurent Amelot, « Visite de Xi Jinping à Paris : pour une parole sans équivoque de la France », Le Figaro, 5 mai 2024, disponible ici.
(2) Jean Lévi, La Chine en guerre, Arkhé, 2018.
(3) L’Art de la guerre et six autres textes de la pensée politique et stratégique chinoise sont rassemblés par Shenzong, le sixième empereur de la dynastie Song (960-1279). Une édition de L’Art de la guerre a été retrouvée dans une tombe datant de la dynastie Han (206 av. J.-C.-220 ap. J.-C.). En poste à la mission de Pékin, le jésuite Joseph Amiot paraphrase une traduction commentée mandchoue de L’Art de la guerre, ce qui porte ce traité à la connaissance de l’Europe cultivée (1772).
(4) Les Mandchous sont les héritiers des Jürchen, une ethnie toungouze (les Toungouzes sont un peuple sibérien parlant une langue ouralo-altaïque). Alors qu’ils conquièrent la Chine, les Jürchen prennent le nom de « Manchous » qui signifie « grands/forts ». Les souverains mandchous ont conservé leur identité ethnique, leur langue et leur système d’écriture, dérivé de l’alphabet araméen par l’entremise des Sogdiens et des Ouïghours.
(5) L’appellation d’empire lui est conférée par les Occidentaux, à la recherche d’un terme adéquat pour dénommer les formations politiques prémodernes qu’ils rencontrent dans leur entreprise d’arraisonnement du monde, des Grandes Découvertes au premier tiers du XXe siècle. Le « pays du Milieu » (Zhongguo), ou encore la « fleur du Milieu » (Zhonguua), autrement dit la Chine, est au cœur d’une constellation de royaumes, principautés et peuples tributaires. Originellement, « Milieu » renvoie à la Plaine centrale (bassin du fleuve Jaune), là où l’ethnogenèse des Han s’est produite. Toutefois, les recherches archéologiques des dernières décennies montrent que l’espace géographique dans lequel la civilisation chinoise s’enracine originellement est situé plus au nord, dans une vaste région liée aux dynamiques de l’Asie centrale et septentrionale (la Sibérie).
(6) Institué en 1760 par un édit impérial, le Co-hong était une guilde de marchands auxquels était confié le monopole du commerce avec leurs homologues occidentaux. Les marchands occidentaux étaient relégués à l’extérieur de la ville, dans un espace restreint et pour une durée limitée.
(7) Xavier Paulès, L’opium : une passion chinoise, 1750-1950, Payot, 2011.
(8) S’il stipule l’abolition du Co-hong et l’ouverture de quatre ports, en sus de Canton, au commerce international, le traité de Nankin (1842) ne mentionne d’ailleurs pas l’opium. Ce trafic est légalisé par la convention de Pékin (1860), à l’issue de la seconde guerre de l’Opium.
(9) En 1860, le Britannique Charles Gordon (1833-1885), avec l’accord de son gouvernement, se met au service de la dynastie Qing afin de lutter contre les Taiping. Il contribue à la réorganisation de l’armée, dégage la ville de Shanghaï, libère Suzhou et d’autres villes. Charles Gordon est dès lors appelé « le Chinois ». Également surnommé « Gordon Pacha » après avoir lutté contre le trafic d’esclaves au Soudan (1874-1879), il meurt à Khartoum, le 26 janvier 1885, lors de la prise de la ville par le Mahdi et les tribus esclavagistes du Soudan (la « guerre des Mahdistes », 1881-1899).
(10) L’expression renvoie à ce qu’Henry Kissinger nomme « le programme de Wei Yuan ». Mandarin lié à Lin Zexu, le fonctionnaire qui avait fait brûler les caisses d’opium à Canton (1839), Wei Yuan est l’auteur d’un traité de géographie visant à développer une diplomatie rénovée, au-delà des pays tributaires voisins. Il propose de s’accrocher au traité de Nankin tout en instaurant des relations avec des pays susceptibles de contrebalancer le poids de l’Angleterre (la France et les États-Unis d’Amérique). Voir Henry Kissinger, De la Chine, Fayard, 2011, p. 78-81.
(11) Il s’agit d’une révolte estudiantine à Pékin alors que la Conférence de la Paix, réunie à Paris depuis janvier 1919, négocie le traité de Versailles et le sort des possessions allemandes en Chine et dans le Pacifique. À l’information selon laquelle le Japon conserverait Qingdao et la péninsule du Shandong, pris à l’Allemagne au début de la Première Guerre mondiale, les étudiants de l’Université de Pékin manifestent. Ce mouvement renforce le nationalisme chinois et donne un tour plus radical encore aux réformes des débuts de la république (voir le slogan « À bas la boutique Confucius »). Dans le prolongement de cette vague, le Parti communiste chinois est fondé à Shanghaï (1921).
(12) Pour prix de ses bons offices lors de la deuxième guerre de l’Opium, l’Empire russe obtient de la Chine la cession de la Mandchourie extérieure, ce qui correspond à l’actuel Extrême-Orient russe (1858-1860). Est fondé le port de Vladivostok. À l’issue de la guerre de 1895, le Japon dispose de l’île de Formose, étend son influence à la Corée et ses dirigeants ont des vues sur la Mandchourie. Après une guerre victorieuse contre la Russie (1904-1905), la Mandchourie entre effectivement dans leur zone d’influence. Le projet d’un Grand Japon, nouvelle puissance hégémonique au centre d’une sphère asiatique est dès lors envisagé. En d’autres termes, le Japon entend prendre la place historique de la Chine.
(13) Il faut ici se remémorer le prestige du Japon après sa victoire contre la Russie impériale, lors de la guerre de 1904-1905. Nombre de futurs dirigeants et militants nationalistes chinois furent formés dans les universités japonaises.
(14) La République de Chine comprend aujourd’hui l’île de Taïwan, les Pescadores, les archipels Quemoy et Matsu ainsi que Taiping. De part et d’autre du détroit de Formose, la disproportion est énorme : 36 000 km² et 23 millions d’habitants pour la République de Chine ; 9,6 millions km² et 1 375 milliards d’habitants pour la République populaire de Chine.
(15) Jean-Sylvestre Mongrenier et Laurent Amelot, Pourquoi faut-il soutenir l’île-État de Taïwan ?, Institut Thomas More, note d’actualité 66, avril 2020, disponible ici.
(16) Le géographe Hu Huanyong est surtout connu en Occident pour avoir identifié et tracé la diagonale qui sépare la Chine peuplée de l’Est de la Chine aride et sous-peuplée de l’Ouest (la « ligne de démarcation géo-démographique » Heihe-Tenchong), en 1935.
(17) Emmanuel Dubois de Prisque, « La cartographie en Chine du rêve chinois à la réalité géopolitique », Outre-Terre, n°38, 2014/1.