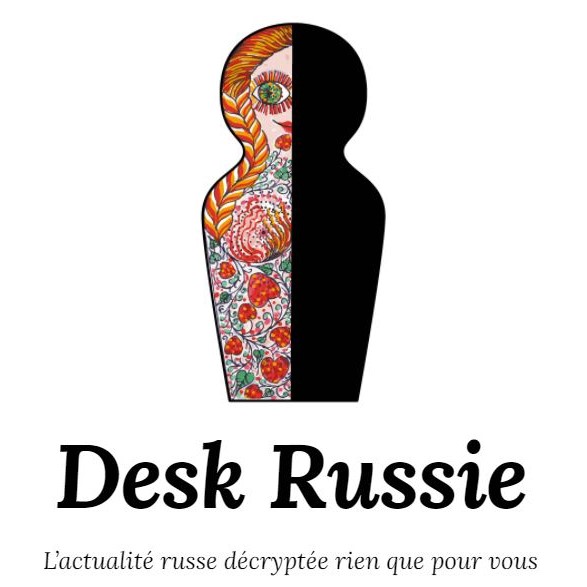16 juin 2024 • Analyse •
16 juin 2024 • Analyse •
Depuis que le massacre perpétré par le Hamas, le 7 octobre 2023, a déclenché une guerre dans la bande de Gaza, la République d’Afrique du Sud est à la tête de l’offensive juridique internationale contre l’État d’Israël. Ainsi ses dirigeants se posent-ils en porte-voix du « Sud global ». Au vrai, la posture ne saurait occulter l’importance de ses liens politiques, diplomatiques et militaires avec la Russie. Et l’ébranlement du pouvoir de l’ANC (le Congrès national africain), lors des dernières élections législatives, ne devrait pas remettre en cause l’essentiel de cette « relation spéciale ». Il faut cesser de prendre l’Afrique du Sud pour une sorte de démocratie libérale sur le continent africain. Analyse pour Desk Russie.
On sait l’importance que Moscou accorde à l’Afrique, continent dans lequel les stratèges du Kremlin élaborent et conduisent des stratégies indirectes, dites « obliques », contre l’Occident. L’implantation de forces russes en Libye, ainsi que la poussée sur l’axe Soudan-Centrafrique-Sahel, ont déjà défrayé la chronique géopolitique (1). D’autant qu’on avait un temps minoré cette percée diplomatique et militaire, l’analyse se limitant parfois au décompte des effectifs militaires russes (mineurs) ainsi qu’à l’évaluation du commerce russo-africain. Cependant, les Russes ont su faire beaucoup avec peu, au point d’évincer les Français du Sahel, ce qui constitue un fait diplomatico-stratégique majeur.
Un aperçu des relations entre l’Afrique du Sud et la Russie
Si, vu de France, les enjeux de l’Afrique australe ne semblent pas tellement prégnants, la République d’Afrique du Sud n’en est pas moins importante aux yeux du Kremlin. L’histoire proche et le soutien apporté par l’URSS à l’ANC (le Congrès national africain) à l’époque de l’apartheid expliquent en partie ce fait. De nombreux cadres de l’ANC, aujourd’hui au pouvoir, furent accueillis et formés en URSS. Engagée politiquement, idéologiquement et militairement dans les guerres de Namibie et du Mozambique, l’URSS se heurtait, directement et indirectement, au pouvoir sud-africain d’alors.
À l’époque, l’Afrique australe était donc l’un des « fronts chauds » de la guerre froide. On se souvient du brusque effondrement de l’empire portugais en Afrique, en 1975, et de l’intervention soviéto-cubaine en Angola et au Mozambique qui suivit immédiatement, pour appuyer et soutenir les guérillas marxistes-léninistes dans leur conquête du pouvoir. Les États-Unis étaient alors entravés dans leur action extérieure par les conséquences de la guerre du Vietnam, du Watergate et d’une profonde crise morale et politique (le « malaise américain ») (2). Il faudra l’élection de Ronald Reagan, en novembre 1980, pour que les États-Unis exorcisent le « spectre du Vietnam ».
En Afrique australe, la lutte contre le communisme reposait essentiellement sur Pretoria, en opposition aux menées de l’URSS, du bloc soviétique et de leurs affidés locaux (pouvoir et guérillas marxistes-léninistes). Sur le plan diplomatique, les relations entre Pretoria et Moscou furent rompues en 1956 pour n’être rétablies qu’en 1992, au moment où les deux pays s’engageaient dans une autre époque (dislocation de l’URSS et démantèlement de l’apartheid en Afrique du Sud). Deux ans plus tard, à l’issue d’élections multiraciales (1994), l’accès de l’ANC au pouvoir renouvelait profondément les relations entre la Russie post-soviétique et l’Afrique du Sud post-apartheid.
Dans ce nouveau contexte et plus encore aujourd’hui, le Kremlin considère l’Afrique du Sud comme la principale puissance d’Afrique subsaharienne, avant le Nigéria ; un point d’appui pour sa stratégie continentale, mais aussi pour ses ambitions à l’échelle du « Sud global » et du monde. De fait, l’Afrique du Sud constitue un vaste pays (1,2 million de km2 ; 60 millions d’habitants), relativement développé et riche en minerais de toutes sortes. Outre le secteur du diamant, dominé par le duopole Moscou-Pretoria, mentionnons le platine, dont l’Afrique du Sud est de très loin le premier producteur mondial (90 % de la production), devant la Russie (3).
Dans l’ordre géopolitique, l’Afrique du Sud est réputée influente sur le continent. Au sein de l’Union africaine comme dans la SADC (Southern Africain Development Community), elle se révèle incontournable. À l’échelon mondial, l’Afrique du Sud est membre du G20 et participe au forum IBSA (Inde, Brésil, Afrique du Sud). Le passé récent (la lutte contre l’apartheid) et la mémoire de Nelson Mandela assurent à sa diplomatie un certain rayonnement dans le « Sud global ». Et Moscou ne fait pas faute de rappeler l’appui autrefois apporté, quand bien même celui-ci s’inscrivait dans une logique de la guerre de classe contre les « États bourgeois », sans grand rapport avec le sort de l’Afrique, dans le but de bouleverser la « corrélation des forces ».
Le pseudo-émergent sud-africain
Fort habilement, le pouvoir russe sut transformer le concept géoéconomique hasardeux de BRIC (le regroupement hétéroclite du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine) en un forum diplomatique non dénué d’efficacité. En 2009, l’Afrique du Sud fut donc conviée à un sommet des BRIC, réunis à Ekaterinbourg (Russie). Dès lors, les BRIC, devenus BRICS ( « S » pour South Africa) se poseront en rivaux de l’Occident et des institutions de Bretton-Woods (FMI et Banque mondiale). En dépit d’étroits liens commerciaux et financiers avec les États-Unis et l’Europe, le « pouvoir ANC » sud-africain n’a pas varié et soutient les positions de l’axe sino-russe.
Sur le plan bilatéral, les relations entre Moscou et Pretoria sont supervisées par plusieurs institutions mixtes — Conseil d’affaires russo-sud-africain, Comité mixte intergouvernemental pour la coopération économique, Commission mixte pour la coopération technologique et scientifique —, et l’Afrique du Sud constitue le premier partenaire économique de la Russie en Afrique subsaharienne. De nombreux axes de coopération sont mis en avant dans le domaine des infrastructures, ceux de l’énergie, du secteur minier, de l’aéronautique, des télécommunications ou encore de l’agriculture.
Certes, il importe de rappeler que les intérêts économiques et commerciaux de la Chine populaire et du Brésil, voire ceux de l’Inde qui s’appuie sur sa diaspora (formée à l’époque du British Empire), demeurent très supérieurs à ceux de la Russie. À Moscou, l’Afrique du Sud a pu être vue comme le « maillon faible » des BRICS, d’autant plus qu’elle ne fait pas le poids, quel que soit le compartiment de puissance. C’est par idéologie et pour des raisons d’équilibre géopolitique que l’Afrique du Sud fut cooptée et insérée dans le conglomérat des BRICS : Pretoria était le vecteur d’un panafricanisme anti-occidental. On notera la prétention de Moscou au leadership idéologique au sein des BRICS.
Toutefois, les deux capitales ont signé un important contrat sur la construction de réacteurs nucléaires russes en Afrique du Sud, et ce au détriment du français Areva. Qui plus est, il s’avère que la diplomatie sud-africaine, nonobstant les relations commerciales et financières du pays avec l’Occident, n’est pas le simple reflet de l’infrastructure économique : elle n’a guère varié dans son tropisme russophile, l’invocation du non-alignement, et autres scories linguistiques du tiers-mondisme, qui n’abuse que ceux qui le veulent bien.
Certes, les récentes élections législatives en Afrique du Sud ont été l’occasion de révéler au monde la grave situation dans laquelle les gouvernements de l’ANC ont conduit le pays (4). Au départ, les premiers gouvernements post-apartheid ont bénéficié de l’effet d’inertie (au sens cartésien du terme) de l’économie sud-africaine et, pour ainsi dire, n’ont pas immédiatement mangé le capital. D’aucuns pensaient alors qu’une Afrique du Sud industrialisée, dynamique et ouverte au marché mondial serait un pôle de développement et un centre organisateur du continent, selon une logique d’association et de partenariat avec l’Occident. Réalisateur d’Invictus (la version cinématographique du « miracle sud-africain »), Clint Eastwood lui-même céda au lyrisme de la « nation arc-en-ciel ».
Impéritie et radicalisation de l’ANC
Las ! L’impéritie des dirigeants issus de l’ANC fut évidente avant même la désastreuse présidence de Jacob Zuma (2009-2018) (5). Simplement, de nouveaux seuils furent franchis dans la corruption et le pillage du pays, ce que le rapport d’une commission d’enquête, constituée après la démission de Jacob Zuma, nomme la « capture de l’État ». Une clique politico-affairiste fit main basse sur l’appareil d’État, et les niveaux de corruption sont aujourd’hui encore stratosphériques, même au regard des critères locaux. L’absence de réelle condamnation de Jacob Zuma, très brièvement incarcéré pour outrage à magistrat, donne une idée de la situation (les émeutes en réponse à cette incarcération firent 300 morts).
Au demeurant, son successeur, Cyrille Ramaphosa, n’a pas inversé le phénomène, tant celui-ci est causé par des forces profondes. À certains égards, la situation (coupures d’électricité plusieurs heures chaque jour, coupures d’eau, écarts socio-économiques gigantesques, criminalité galopante) est pire qu’à l’époque de l’apartheid. En revanche, le président sud-africain et l’ANC se sont distingués par leur complaisance envers l’agression russe en Ukraine (absence de condamnation au sein même de l’Assemblée générale des Nations Unies) (6), leur hostilité à l’encontre d’Israël (action auprès de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale) et de coupables faiblesses pour le Hamas. En gros, la guerre d’Ukraine est une « histoire de Blancs », sans importance, mais celle de Gaza est le péché de l’Occident et la tragédie de toute l’humanité non occidentale.
Bref, Pretoria joue la partition la plus conforme qui soit au jeu diplomatique de la Russie et de la Chine populaire, dénonciatrices des « doubles standards » et hérauts de la « majorité mondiale » (l’expression russe pour « Sud global »). D’aucuns se gausseront de ceux qui voient partout la « main de Moscou ». Disons simplement que la position des hommes de l’ANC est conforme à l’histoire longue de leurs rapports avec la « Russie-Soviétie » et exprime leur vision du monde. Nul besoin de postuler que ces gens seraient de simples pions entre les mains de Vladimir Poutine. Toutes choses égales par ailleurs, la situation est « préformée » : les cadres existants et les héritages historiques délimitent le champ des possibles et influencent la définition des politiques et des stratégies.
À raison, les pays membres du G7 n’ont pas renoncé à renforcer leur marge de manœuvre diplomatique dans ce que l’on nomme le « Sud global », dont l’Afrique du Sud se veut l’un des principaux porte-voix. Notons cependant que cette dernière n’était pas présente lors du sommet du G7 à Bari (Italie), les 13 et 14 juin derniers, pas plus qu’elle ne sera représentée, les jours suivants, à la Conférence sur la paix en Ukraine (Nidwald, Suisse, 15-16 juin 2024).
Faut-il penser que le recul de l’ANC, lors des dernières élections législatives (29 mai 2024), et la possibilité d’un gouvernement de coalition avec l’Alliance démocratique (AD) (7) — une structure proche du monde des affaires, présentée comme le « parti des Blancs » —, auront des conséquences favorables sur le plan diplomatique, la raison mettant fin aux jeux pervers de Pretoria ? On retrouve ici l’idée des « intérêts bien compris », déguisée en sagesse des nations.
D’une part, l’ANC représente tout de même les deux cinquièmes des électeurs (contre 57,5 % en 2019) (8), ce qui lui assure la perpétuation d’un rôle majeur dans la politique sud-africaine. Or nous avons vu que sa diplomatie exprime son histoire et son ADN idéologique. D’autre part, Jakob Zuma et son nouveau parti, le MK (le « Fer de lance de la nation »), qui a récupéré le logo de la branche combattante de l’ANC, ainsi que le EFF (les « Combattants pour la liberté économique », un parti qui milite pour la confiscation des terres des fermiers blancs), sont en embuscade (9).
En guise de conclusion
Enfin, il devrait être évident que les vertus pacificatrices et stabilisatrices de la « raison utilitaire », censée guider l’action d’un hypothétique pacte de gouvernement entre l’ANC et l’AD, sont sujettes à caution. Cette thèse n’est jamais que le succédané de celle de la paix par le commerce et de la dissolution de l’hostilité dans les délices du grand marché mondial. À l’expérience des faits, la guerre et différentes formes de conflits ont tôt fait de générer leurs propres « business », avec leurs concussionnaires et affairistes qui ont leur propre idée de ce que sont les intérêts bien compris de leurs pays respectifs. En l’occurrence, dans le monde tel qu’il devient, il y a certainement place pour le développement des relations commerciales entre l’Afrique du Sud et le groupe des puissances révisionnistes, dont la Russie se veut le fer de lance, cet axe du chaos qui entend mettre à bas l’Occident.
Loin de déboucher sur un quelconque rééquilibrage politique, idéologique et diplomatique, la gabegie et la corruption du « pouvoir ANC » pourrait encore radicaliser l’Afrique du Sud dans son discours et son positionnement international. Si les diplomates occidentaux ne doivent évidemment pas renoncer à négocier avec Pretoria, il importe de faire sienne la lucidité tragique de Julien Freund : « Prévoir le pire pour qu’il n’advienne pas ». Cela suppose rompre en visière avec une philosophie de l’histoire paresseuse, qui voudrait que tout finisse par s’arranger. Bien au contraire, les choses peuvent encore s’aggraver, en Afrique comme sur tout le théâtre du monde et jusque sur les champs de bataille des démocraties occidentales. En somme, il faut faire sienne une forme de « catastrophisme raisonné ».
Notes •
(1) Jean-Sylvestre Mongrenier, « Wagner au Mali : l’arbre ne doit pas cacher la forêt », Desk Russie, 8 octobre 2021, disponible ici.
(2) Publié en 1977, le Plaidoyer pour une Europe décadente de Raymond Aron restitue l’ambiance psycho-historique de cette époque au cours de laquelle les équilibres stratégiques mondiaux menaçaient de basculer en faveur de l’URSS.
(3) Notons cependant le manque d’investissements extérieurs dans le secteur minier sud-africain, du fait de l’état des infrastructures ferroviaires, de coupures d’électricité quasi-constantes (335 jours de délestage en 2023, jusqu’à 12 heures par jour), plus généralement en raison du détestable climat politico-judiciaire et de la corruption. Significativement, le géant minier australien BHP Group serait prêt à racheter son grand concurrent Anglo-American, mais seulement s’il était délesté de ses actifs sud-africains.
(4) Mathilde Boussion, « Afrique du Sud : l’étoile pâlissante du Sud global », Le Monde, 26-27 mai 2024.
(5) Cf. Mathilde Boussion, « En Afrique du Sud, la revanche de Jacob Zuma », Le Monde, 3 juin 2024.
(6) Au printemps 2023, l’Afrique du Sud fut soupçonnée par les États-Unis de livrer des armes à la Russie, avec l’appui de ses services de renseignement (des armes chargées sur le cargo Lady-R, dans le port de Simon’s Town, au Cap, entre les 6 et 8 décembre 2022). Le Comité national pour le contrôle des armes conventionnelles a repoussé les accusations de l’ambassadeur américain, formulées le 11 mai 2023. Au début de cette même année, dans la foulée d’une visite de Sergueï Lavrov (janvier 2023), la marine sud-africaine a participé à des exercices militaires avec la Russie et la Chine populaire. La frégate russe Amiral-Gorshkov était affublée de la lettre Z, en référence à l’ « opération spéciale » lancée le 24 février 2022.
(7) L’ANC a regroupé 40,2 % des suffrages et l’AD 21,7 %.
(8) Soit 159 sièges sur 400, contre 230 en 2019.
(9) Jakob Zuma n’a pu être candidat à un poste de député en raison d’une condamnation pour outrage à magistrat, mais le MK, fondé après son exclusion de l’ANC et sa brève période d’emprisonnement, est désormais la troisième force politique du pays avec 14,5 % des voix. Sur ses terres, dans la province-clef du Kwazulu-Natal, le MK se place même en première position avec 45 % des suffrages, reléguant l’ANC à la troisième place. Le parti nationaliste noir d’extrême-gauche EFF a réuni 9,5 % des suffrages.