
 Novembre 2024 • Note 70 •
Novembre 2024 • Note 70 •
« La France est un pays conquis par son administration. »
Victor de Broglie, 1861
Le débat sur le budget 2025 est en cours. Lors de sa présentation le 10 octobre dernier, le gouvernement présenta un certain nombre de hausses d’impôts et de taxes pour faire face à un déficit plus grave encore que prévu (6,1 % du PIB au lieu de 5,1 % annoncé au printemps) : contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus, taxe sur les « superprofits », taxe sur les billets d’avion, hausse du malus automobile sur les véhicules les plus polluants, relèvement de la taxe sur l’électricité, hausse des tarifs des mutuelles, indexation des pensions retraites décalée de six mois, suppression de certaines niches fiscales. L’objectif affiché était d’obtenir près de vingt milliards d’euros, un tiers du plan d’économies de 60 milliards prévu sur l’année.
Inspirés par l’exemple, les députés ont à leur tour multiplié les taxes et les contributions pendant la phase de discussion des 3 000 amendements déposés : alourdissement de la taxe sur les « superprofits », création de nouvelles taxes sur les « superdividendes », les rachats d’actions, les multinationales, le patrimoine des milliardaires ou encore les « grandes sociétés du numérique ». A l’inverse, plusieurs mesures du texte initial furent supprimées, comme la hausse de la taxe sur l’électricité ou de l’alourdissement du malus automobile. Au total, une hausse d’impôts de 35 milliards d’euros supplémentaires par rapport au projet de loi initial déjà salé. Le texte a finalement été rejeté le 12 novembre par la majorité des députés. C’est donc la version gouvernementale du volet recettes du budget 2025 qui est désormais débattue au Sénat.
Au-delà de l’exaspération et de la consternation du contribuable que nous sommes tous, il convient de prendre de la hauteur pour donner sens à ce concours Lépine de la taxe et de l’impôt. De quoi ce matraquage fiscal atavique, par-delà les oppositions partisanes, est-il le nom ? Jean-François Revel fit de la question de l’étatisme forcené et du dirigisme français l’un des fils rouges de son œuvre de journaliste et d’intellectuel libéral classique. Il nous aidera à répondre à cette question.
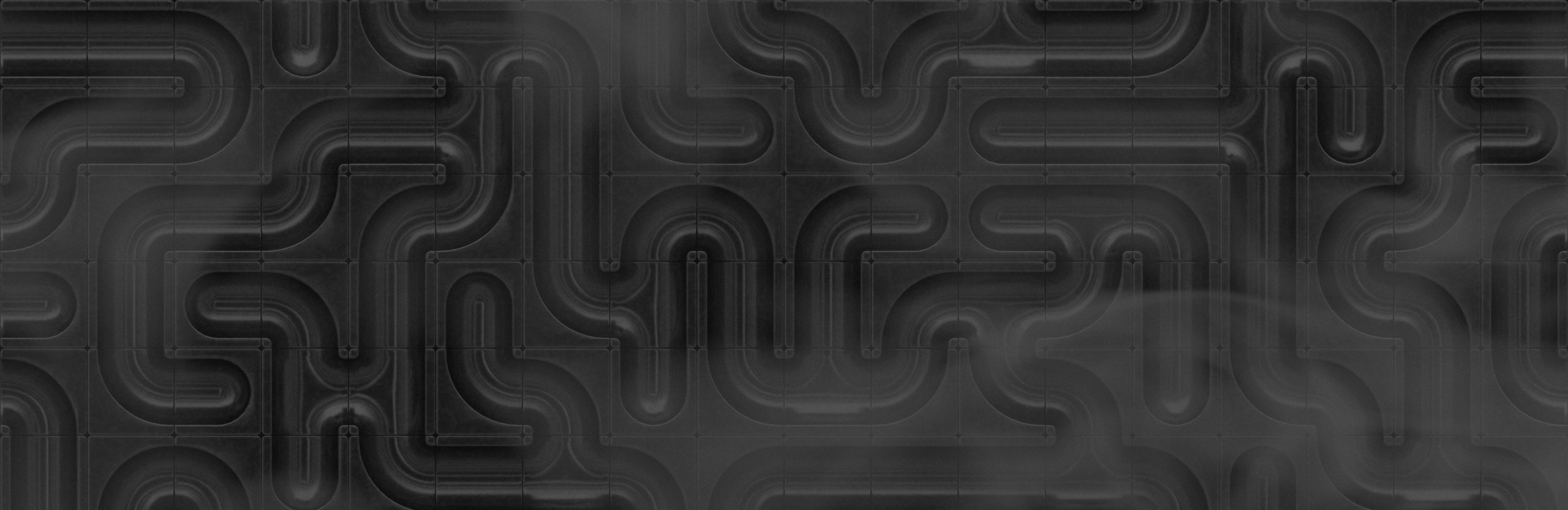
Commençons par noter qu’on a trop pris l’habitude dans notre pays de regarder la question budgétaire et fiscale comme une question technique : il y aurait deux colonnes, les dépenses et les recettes, qu’il s’agirait d’équilibrer soit par la baisse des premières, soit par la hausse des secondes. L’ampleur de la crise financière qui menace la France nous oblige à dépasser ce qui ne serait qu’un exercice comptable et à voir la question budgétaire et fiscale comme une question éminemment politique. En attaquant François Mitterrand et la gestion socialiste, Jean-François Revel y invitait déjà en 1985.
Mais il ne se contentait pas de s’en prendre à la gauche. En dénonçant la « survie de l’utopie socialiste » très au-delà de ses seuls cercles politiques et intellectuels, il s’attachait à montrer que la France restait culturellement attachée aux idéaux collectivistes et dirigistes, malgré leur patent échec pratique. En entretenant sans fin le « mirage de l’État providence », les responsables politiques de droite comme de gauche et les hauts fonctionnaires entretenaient la croyance presque magique, souvent à rebours de l’expérience et de la réalité observée, en l’intervention étatique. Revel dénonçait sans relâche cette dépendance sans cesse accrue envers l’État, l’affaiblissement de la responsabilité individuelle, les freins à la liberté et les entraves à l’innovation et à la prise d’initiative.
De fait, nous nous sommes habitués, au fil de ces cinquante dernières années (qui sont ces décennies qui ont vu sans cesse augmenter la dépense publique et l’interventionnisme de l’État sur la vie économique, sociale et même privée des Français), à raisonner exclusivement à l’intérieur du paradigme étatiste. Dans la seconde moitié du vingtième siècle, « même dans les pays qui, comme les démocraties occidentales, ne sont jamais allées jusqu’à l’État total communiste, totalement producteur et répartiteur, s’est installée une superficie considérable d’État dit « providence » », notait encore Jean-François Revel il y a trente-cinq ans. Ce mouvement généralisé en Occident (il n’est qu’à voir la croissance constante des dépenses publiques sur la longue durée des deux côtés de l’Atlantique) a cependant connu des coups de frein, doux ou brutaux selon les cas, dans un certain nombre de pays à partir des années 1980 : on pense bien sûr aux réformes Reagan aux États-Unis et Thatcher au Royaume-Uni mais on peut aussi citer les profondes réformes de l’État et de l’action publique menées dans les pays scandinaves ou en Allemagne dans les années 2000. Rien de tel en France, où la croissance de l’État a été continue dans ces mêmes décennies : il n’est qu’à rappeler, comme nous le faisons dans la présente note, que le nombre de fonctionnaires a crû d’un million ces vingt-cinq dernières années !
Raisonner à l’intérieur du paradigme étatiste revient à ne pas voir l’évidence : l’accroissement constant des moyens alloués à la puissance publique conduit à celui de son inefficacité. Notre État omnipotent, tentaculaire et dévorateur, qui se regarde comme seul défenseur légitime d’un « intérêt général » de moins en moins évident aux yeux de la communauté des citoyens, est en réalité un État faible, pauvre, lent, tatillon, pusillanime et aboulique. Les graisses ont dévoré les muscles, la gestion des moyens a dévoré la poursuite de l’objectif, le mangement la politique. Jamais l’administration et la haute fonction publique n’ont autant dominé l’État et pesé sur le pays que sous la présidence d’Emmanuel Macron, prétendument libéral et modernisateur.
Mais cette extension sans fin du domaine et des moyens d’intervention de l’État a un autre effet, précieux pour les responsables politiques en ces temps de défiance populaire généralisée : la justification, voire la relégitimisation, du pouvoir politique. Jean-François Revel, encore une fois, avait vu juste : « La socialisation rend inéluctable l’augmentation de volume et de poids du pouvoir politique, du nombre et de la puissance de ceux qui l’exercent, le servent, le soutiennent ou gravitent autour de lui ».
Cet étatisme acharné, ce dirigisme spontané, cette méfiance pour la liberté, le sociologue Mathieu Bock-Côté lui a donné un nom : le « socialisme mental ». La formule vise juste car elle renvoie cet étatisme à sa source historique et philosophique originelle en même temps qu’elle suggère qu’elle fonctionne comme une évidence, un impensé chez ceux qui agissent en son nom. Jean-François Revel ne dénonçait pas autre chose lorsqu’il blâmait les élites françaises de se complaire dans les « méfaits de l’étatisme » au moment même où, partout sur la planète dans les années 1980 et 1990 des pays se libéraient du socialisme.
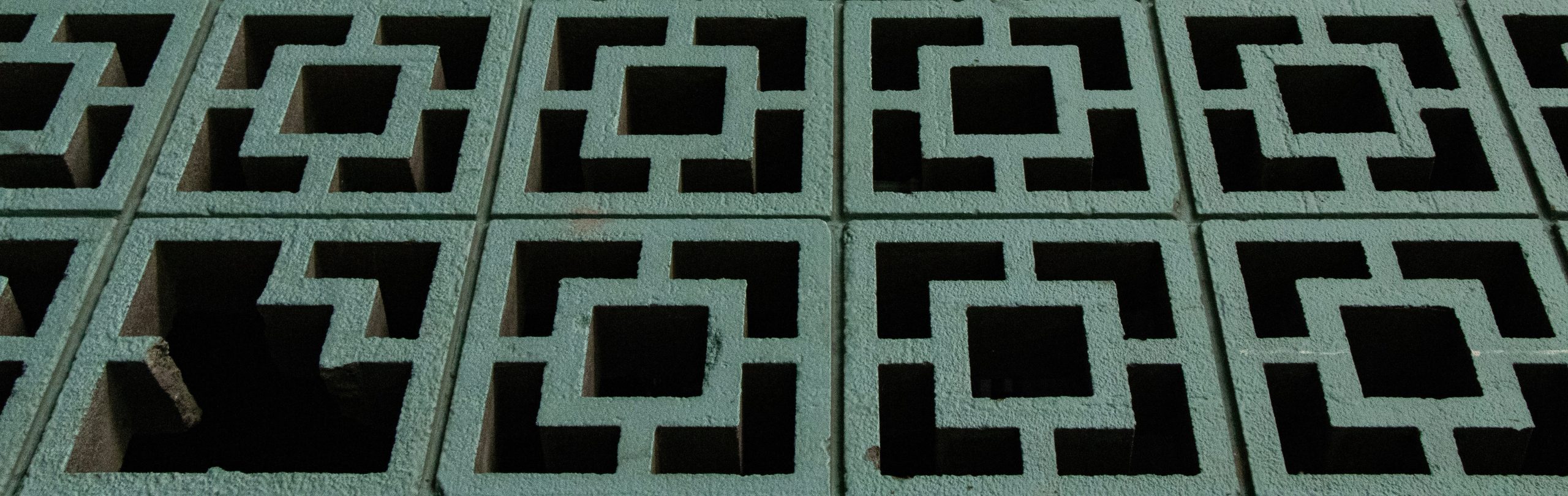
La grande parade continue donc dans notre pays. C’est ce socialisme mental qui explique la situation de la France et la crise qui la menace. Car il apparaît bel et bien que nous en sommes arrivés au terme du modèle économique et social qu’on appelle le « modèle français ». Et même au terme de notre conception traditionnelle de l’État. Les nouvelles augmentations d’impôts dont il est question pour 2025 ne donnent-elles pas qu’un simple sursis à un système qui court objectivement à la faillite ? Quelques milliards de plus, prélevés sur le travail et l’épargne des Français, y changeront-ils quelque-chose ? Non. Ce modèle, que Jérôme Fourquet qualifie pour sa part d’« étato-consumériste », est à bout de souffle et menace incessamment de faire faillite.
Le débat sur budget 2025, dont nous avons rapidement rappelé les grandes lignes en ouverture, prouve que les responsables politiques de droite comme de gauche, de la majorité comme des oppositions, se refusent obstinément à faire leur ce diagnostic et à envisager un autre modèle. S’il n’est pas dans notre intention de développer ici en détails quel serait cet autre modèle (l’Institut Thomas More le fera dans un rapport qui paraîtra bientôt), notons seulement que les réflexions du mouvement post-libéral dans le monde anglo-saxon nous apparaissent la voie à suivre.
La présente note se fixe pour objectif de montrer l’ampleur de l’emprise étatique et de ses effets pervers à laquelle cinq décennies au moins de lâcheté et d’idéologie ont conduit la France. Elle le fait dans quatre domaines : la fiscalité et la dépense publique, l’inflation normative, la boursouflure bureaucratique et les menaces qui pèsent sur les libertés publiques. Elle aurait pu le faire dans bien d’autres champs de l’action publique : la santé, l’éducation, la politique migratoire, etc. Sortir du paradigme étatique ne doit pas conduire à se contenter de réformes de structures. C’est du socialisme mental dont il faut sortir. C’est à l’extension sans fin du domaine de l’État qu’il faut mettre fin.
•

•
Téléchargez la note
•
Les auteurs de la note
| Tristan Audras est diplômé d’un master de Sociologie de l’École normale supérieure Paris-Saclay et titulaire de l’agrégation de Sciences économiques et sociales. Il est aujourd’hui professeur du second degré dans l’Éducation nationale et enseigne dans plusieurs établissements publics et privés des Hauts-de-Seine •
Cyrille Dalmont, directeur de recherche à l’Institut Thomas More, est titulaire d’un master en droit public (Université Lyon 3) et en administration publique (Université de Poitiers). Ancien conseiller parlementaire, il analyse les impacts du numérique sur les libertés publiques et la souveraineté numérique en France et en Europe • Enguerrand Delannoy est administrateur de l’Institut Thomas More. Diplômé de l’ISC Paris, il a été conseiller parlementaire, conseiller en cabinet ministériel et élu local. Ancien auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN), il est aujourd’hui conseiller du président d’une grande collectivité territoriale • Jean-Thomas Lesueur est directeur général de l’Institut Thomas More. il supervise le suivi de la vie politique française au sein de l’équipe de recherche. Depuis quelques années, il travaille en particulier sur les blocages politiques et institutionnels propres au « modèle français », à la décentralisation et à la démocratie locale • |

