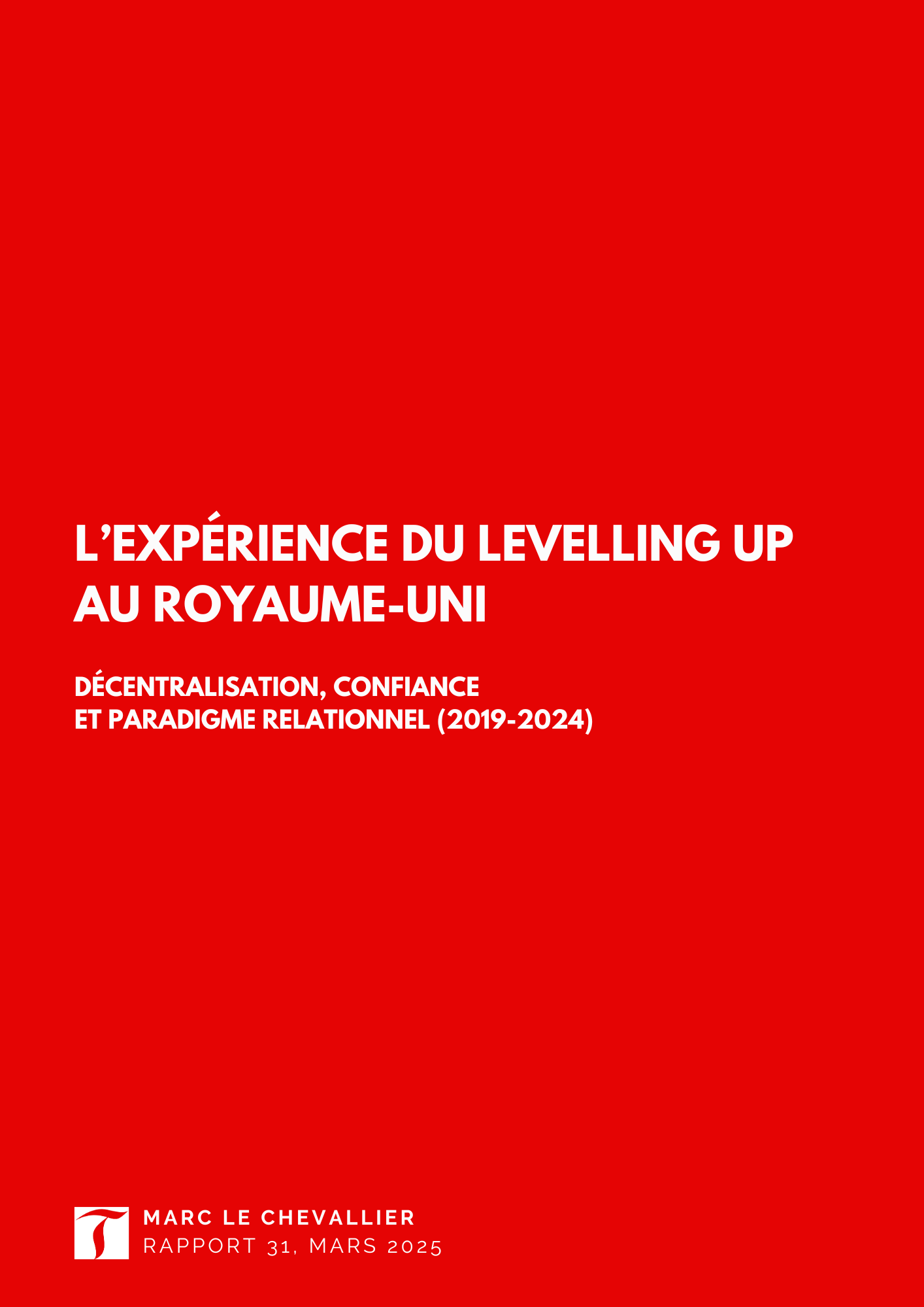Mars 2025 • Rapport 31 •
Mars 2025 • Rapport 31 •
Royaume-Uni 2019 : le Levelling Up comme réponse au Brexit
Lors des élections générales de juillet 2019, le Parti conservateur emporte une victoire historique contre le Labour sur la double promesse de « get Brexit done » (« achever le Brexit ») et de promouvoir le « Levelling Up » (littéralement « nivellement vers le haut »). Pour de nombreux électeurs, notamment issus de régions désindustrialisées et historiquement à gauche, le Brexit exprime une colère politique, mais aussi économique et sociale. Le Levelling Up est la réponse du Parti conservateur à cette colère, la promesse de revitaliser les « left-behind places » (les « territoires laissés pour compte »). Mais, à l’origine de ce programme d’action, on trouve un nouveau paradigme politique. C’est sa conception, sa substance et ses réalisations que le présent rapport entend explorer.

A l’origine du Levelling Up, la recherche d’un nouveau modèle
Le Levelling Up Agenda s’inscrit dans un large mouvement intellectuel né il y a une quinzaine d’années. Un mouvement pluriel et trans-partisan puisque ses promoteurs se trouvent aussi bien chez les Red Tories qu’au Blue Labour. Un mouvement fidèle également à l’empirisme historique anglais, puisque ce sont bien des réponses opérationnelles aux défis économiques et sociaux du pays qu’il cherche à faire émerger. Décentralisation, réforme de l’État-providence, responsabilisation des citoyens, promotion de l’initiative locale, stratégies de croissance territorialisées : les réflexions sont diverses mais convergent vers l’idée qu’il faut inventer un nouveau modèle à la fois de participation politique, de développement économique et de reconnaissance sociale. Le « paradigme étatique », qui a émergé après 1945, et le « paradigme du marché », dominant dans le pays à partir des années 1980, sont épuisés.
Au cœur du Levelling Up, le « paradigme relationnel »
Place donc au « paradigme relationnel ». Nous avons choisi d’employer cette locution pour unifier l’ensemble des notions et des concepts utilisés par les acteurs du Levelling Up, certains de gauche, d’autres de droite, certains intellectuels, d’autres praticiens (« community power », « relational state », « enabling state », « social capitalism », etc.). Partant de l’idée d’un citoyen acteur, capable de se responsabiliser et de contribuer au bien commun, il promeut l’action des corps intermédiaires, de la société civile et des acteurs locaux dans les champs économiques et sociaux. Trois principes, hérités de l’expérience de la Big Society (2010-2013), sous-tendent ce consensus « relationnel » : la contribution, la responsabilité et l’approche locale.

Le Levelling Up Agenda à l’œuvre : décentralisation, redynamisation économique, action sociale
Contribution de chacun à la vie économique, sociale et plus largement au bien commun ; responsabilité personnelle et sociale de chacun ; approche locale comme cadre d’épanouissement de cette contribution et de cette responsabilité : tels sont donc les principes que le Levelling Up Agenda va chercher à concrétiser. Prenant le contrepied de l’approche verticale (top-down) mise en œuvre jusqu’ici, il va agir dans trois directions différentes. Tout d’abord, la décentralisation, avec le développement des « autorités combinées » et la mise en œuvre de la « double dévolution » qui renforce l’autonomie des communautés locales, pour répondre au déficit démocratique en donnant le pouvoir aux acteurs locaux. Ensuite, la redynamisation économique par l’approche régionale, avec de nouvelles compétences économiques confiées aux collectivités territoriales, la création de fonds de régénération ciblés (UK Shared Prosperity Fund et Levelling Up Fund) et la stimulation de projets locaux, pour enrayer le déclin des régions désindustrialisées. Enfin, la valorisation du capital social de chacun, à commencer par les plus fragiles, et une approche de terrain dans les politiques sociales, avec par exemple la démarche dite de « prescription sociale » dans les services sociaux ou l’expérimentation de nouvelles méthodes d’accompagnement et de responsabilisation des personnes fragiles ou précaires, en vue d’une réforme en profondeur de l’État-providence.
Bilan de l’expérience Levelling Up
Le bilan des cinq années de mise en œuvre du Levelling Up est contrasté. Il n’a pas constitué une révolution. Les effets économiques et sociaux du Brexit et de la crise du Covid ont mis à mal son agenda. Mais un certain nombre de réalisations concrètes, mentionnées au paragraphe précédent, sont à mettre à son crédit. Et, à la lumière des succès du mouvement post-libéral aux États-Unis comme au Royaume-Uni, sa fécondité intellectuelle est bien réelle. Le fait que le gouvernement travailliste, en place depuis le mois de juillet 2024, ait repris à son compte plusieurs de ses principes l’indique également. A tâtons, dans le foisonnement de ses conceptions et de ses expériences, le Levelling Up a eu le grand mérite de chercher une réponse à l’épuisement du modèle politique, économique et social du Royaume-Uni – épuisement qui touche tous les pays occidentaux, chacun à sa manière.
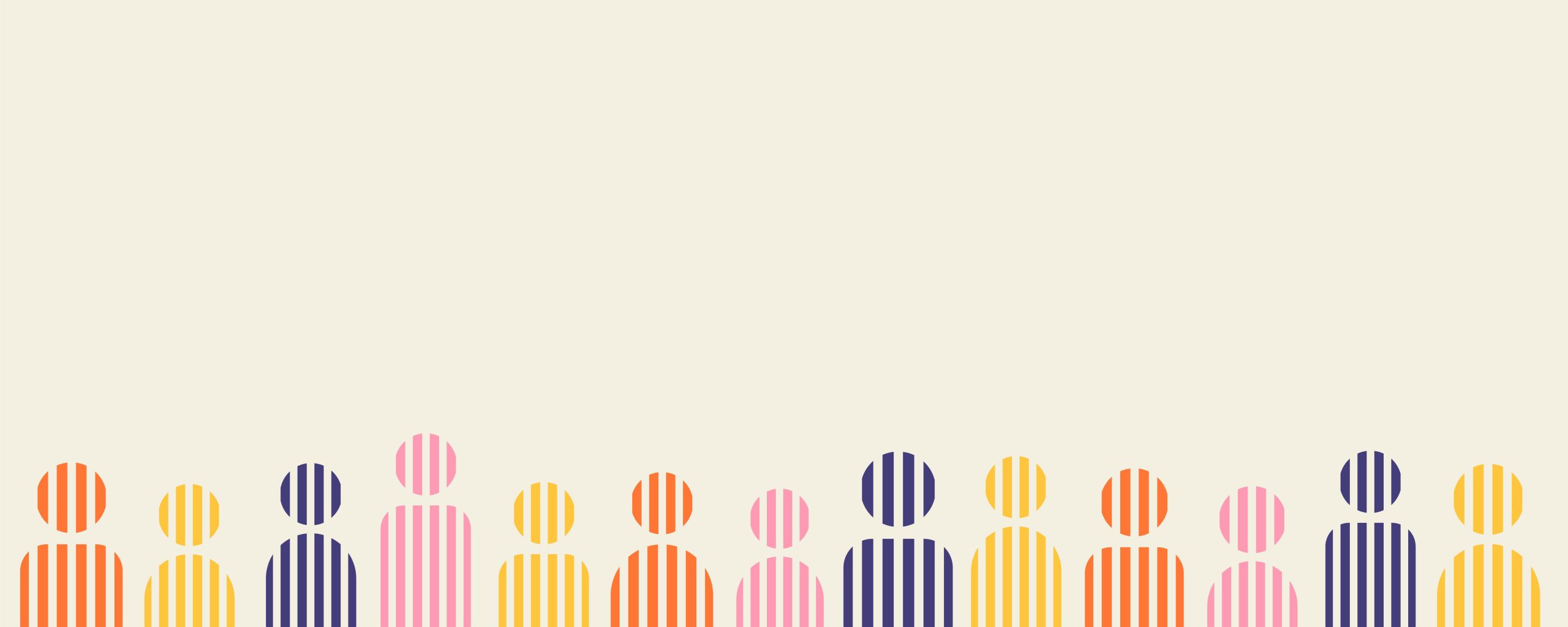
Quels enseignements pour la France ?
Le Royaume-Uni a connu le Brexit, la France la crise des Gilets jaunes. Mais alors qu’outre-Manche, de la Big Society à l’expérience du Levelling Up, une pensée politique novatrice suivie d’un nouveau consensus politique ont émergé, rien de tel n’est observable en France, qui reste prisonnière de son « paradigme étatique ». A chaque crise, de quelque nature que ce soit, une nouvelle réponse de l’État est attendue. Chacun voit pourtant son épuisement et son insuffisance à répondre à la profonde crise, non seulement politique, économique et social, mais morale que traverse notre pays. Le Levelling Up prouve qu’une autre voie est possible, une voie fondée sur la confiance, l’autonomie et la responsabilité des citoyens. Il nous semble que le camp conservateur français, intellectuels et responsables politiques à la fois, aurait tout intérêt à initier une réflexion analogue à celle que son homologue britannique a su faire vivre depuis quinze ans.
Téléchargez le rapport
L’auteur

Marc Le Chevallier est doctorant en philosophie politique au département des sciences politiques de l’UCL (University College London). Il rédige une thèse sur le paradigme relationnel comme levier de réforme en politique. Il est également chercheur en politique publique pour des think tanks au Royaume-Uni et en France. Il travaille actuellement au UCL Policy Lab, un think tank pluridisciplinaire promouvant des partenariats entre le monde politique et le milieu universitaire, où il mène des recherches sur les liens sociaux, le pouvoir relationnel et la cohésion sociale. Il a précédemment travaillé au Centre for Inequality and Levelling Up analysant les inégalités régionales au Royaume-Uni. En 2019-2020, il a été chargé de mission pour le programme « Municipales 2020 », de l’Institut Thomas More qui avait réalisé la cartographie de 183 initiatives locales et formulé 59 propositions d’action sur cinq thèmes clés du scrutin (revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, sécurité, solidarités, écologie locale, développement économique local). Ses travaux portent aujourd’hui sur les réformes de l’État, la subsidiarité, la société civile et les corps intermédiaires, ainsi que sur le rôle des relations humaines et de la confiance en politique • |