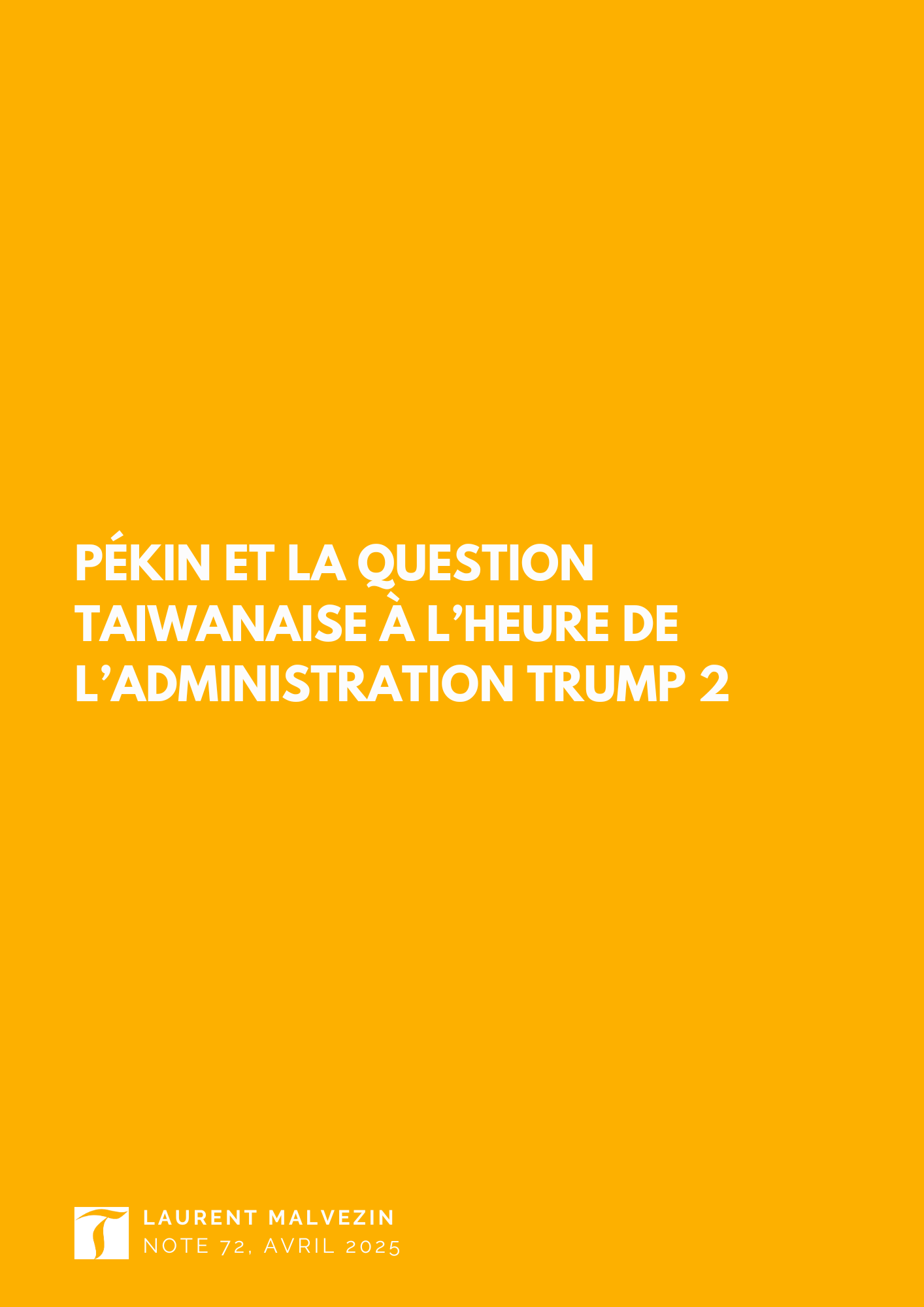Avril 2025 • Note 72 •
Avril 2025 • Note 72 •
Entrer au cœur de la vision de Pékin pour comprendre la mise à jour de sa stratégie vis-à-vis de Taiwan
Pour prendre la bonne mesure de la politique du Parti communiste chinois (PCC) à l’égard de Taiwan, il convient de comprendre la spécificité de son système politique et de son idéologie dans leur rapport au réel. Son discours se veut performatif. Ses fondamentaux, ses inflexions, ses accélérations, doivent être analysés en dynamique afin de comprendre comment ils s’adaptent aux circonstances politiques et internationales. L’élection présidentielle taïwanaise qui a vu la victoire de Lai Ching-te en janvier 2024 et, plus encore, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche constituent des facteurs de changement majeurs. La présente note propose l’analyse détaillée du récit officiel de Pékin, et de la stratégie associée, pour rendre compte de ce que met en place le régime actuellement pour reprendre possession de Taiwan.

La ligne affichée par Pékin : un processus d’unification par « voie pacifique »
Pour qualifier sa politique à l’égard de Taiwan, le Parti communiste chinois (PCC) parle de « processus d’unification » des deux rives du Détroit. Ce concept est le fruit de quarante années de maturation depuis le « Message aux compatriotes de Taiwan » du 1er janvier 1979 par Deng Xiaoping. Dans un discours de 2019, Xi Jinping rappelle les deux composantes majeures de la ligne ainsi définie : l’« unification par voie pacifique » et « un pays, deux systèmes ». Les textes du PCC promeuvent une « unité de cœur et d’esprit » commun à la patrie et au peuple chinois en vue de ne former qu’« une seule et même famille dans le Détroit ».
Une posture chinoise qui se durcit
Les modalités de cette intégration dite « pacifique » sont néanmoins, pour une majorité d’entre elles, de nature prescriptive et coercitives. Elles se situent en deçà du seuil de la guerre mais, on s’en doute, n’ont rien de pacifiques en ce qu’elles sont décidées unilatéralement, sans l’aval des autorités et de la population taiwanaise autour d’un processus global préétabli. De plus, la tenaille de la « lutte contre l’indépendance » et de « la promotion pour l’unification » a exercé une pression croissante durant l’année 2024 qui a débuté avec l’élection du président Lai Ching-te à Taiwan et s’est terminée avec la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Le 8 mars dernier, un porte-parole du ministère chinois de la Défense menaçait directement les militants indépendantistes taïwanais : « plus ils feront de l’esbroufe, plus la corde se resserrera autour de leur cou ».

L’incertitude Trump
Depuis le retour de Donald Trump, plusieurs signaux, faible à ce stade, laissent augurer d’un changement de doctrine des Etats-Unis à l’égard de Taiwan. Il n’est cependant pas possible d’en tirer des conclusions définitives à ce stade. Pour autant, nous pouvons considérer que Pékin, pour qui les véritables contradictions sont d’ordre dialectique, analyse ces prises de position comme un signe de faiblesse et d’hésitation, plutôt que comme la manifestation de l’« ambiguïté stratégique » traditionnellement attachée à la posture américaine. Le PCC peut y voir davantage d’espace pour aller de l’avant dans le « processus d’unification ».
Transactionnalisme trumpien vs. donnant-donnant chinois
Si, du côté des médias chinois, les spéculations vont bon train sur le lâchage de Taiwan par Washington. la prudence prévaut du côté officiel. Pékin s’attend à une offre globale de la part de Donald Trump et Taipei craint d’être la victime de ce « super deal ». A raison. Car, à l’école du transactionnalisme, il est possible que Donald Trump présume un peu trop de ses forces. Depuis plusieurs décennies, la Chine a démontré qu’elle a su développer, sans coup férir, une montée en puissance « pacifique » dans tous les domaines. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
•
Téléchargez la note
•
L’auteur

Laurent Malvezin est chercheur associé à l’Institut Thomas More. Ancien élève de l’Université de Pékin (1990-1993) et diplômé de chinois à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO-Paris), il a commencé sa carrière comme analyste et conseiller Chine au ministère des Armées. Il a ensuite été directeur des études pour l’Asie dans un cabinet de prévention des risques des entreprises françaises et européennes. A partir de 2014, il poursuit cette activité au sein du cabinet Montsalvy Consulting Firm qu’il a créé. En 2013, il est membre fondateur du Cercle K2. Intervenant dans les entreprises et les institutions publiques (École Nationale de la Magistrature ENM, Fondation Bru, IHEDN-ANAJ, INHESJ, etc.), il contribue à des revues spécialisées (Géopolitique, Hors les murs, etc.) et dans la presse nationale (Le Monde, Les Echos, etc.). En mars 2025, il rejoint l’équipe de l’Institut Thomas More pour travailler sur les enjeux politiques et économiques de la montée en puissance de la Chine • |