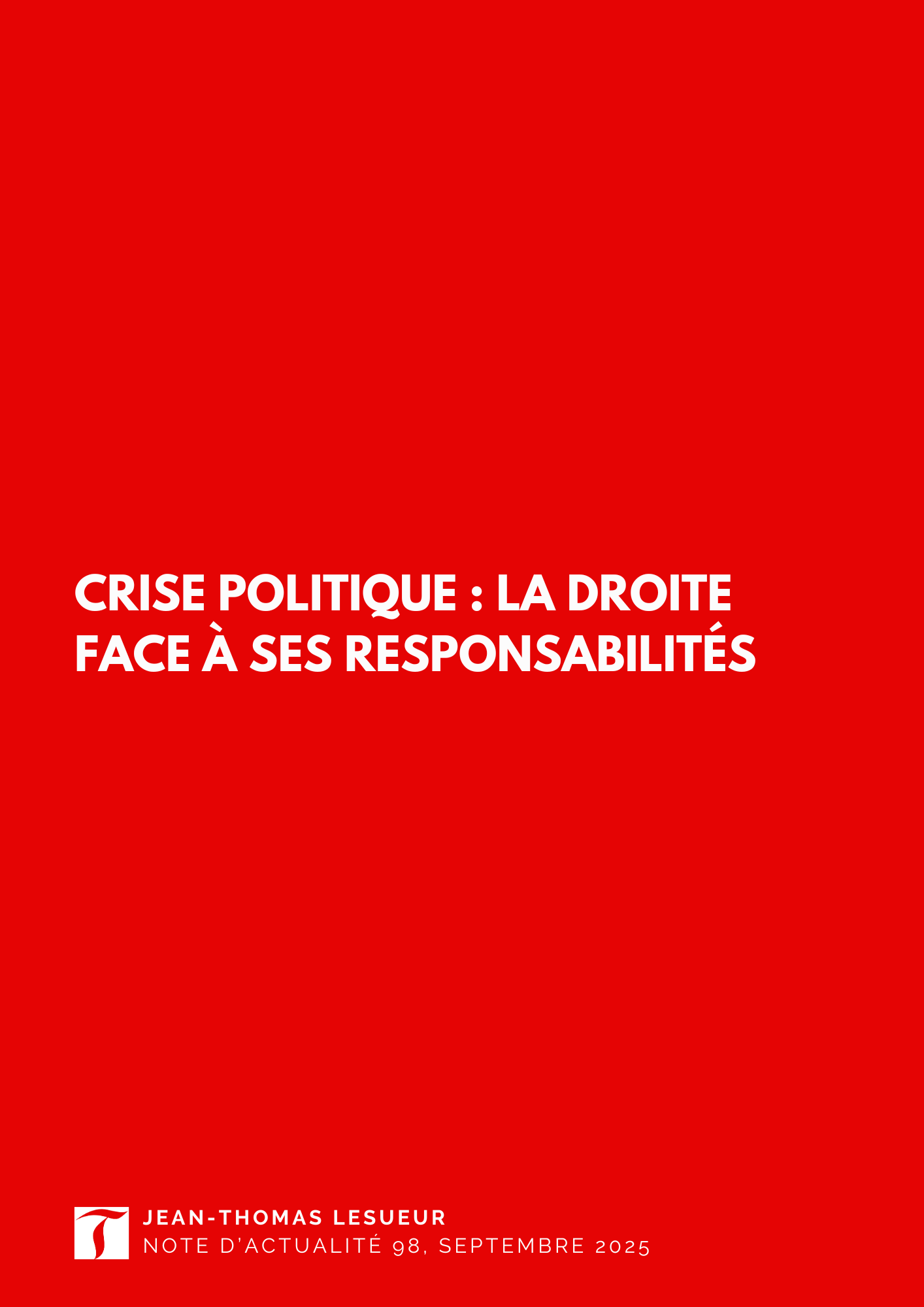Septembre 2025 • Note d’actualité 98 •
Septembre 2025 • Note d’actualité 98 •
Le vote de confiance réclamé à l’Assemblée nationale par le Premier ministre François Bayrou le 8 septembre prochain plonge de nouveau la France dans une confusion profonde. Le blocage institutionnel prévisible aggrave la situation financière, économique et sociale du pays et les mouvements sociaux qui s’annoncent assombrissent encore les perspectives. Dans ce contexte, l’avenir de la droite, en crise depuis des années, est incertain. Il est trop facile néanmoins de s’en prendre à Emmanuel Macron ou au Rassemblement national. Jean-Thomas Lesueur explique pourquoi la droite est la première responsable de ce qui lui arrive. Il rappelle rapidement quarante années d’incurie, de lâcheté intellectuelle et de fautes stratégiques. Il propose une voie, pour le moins escarpée il est vrai, pour lui faire retrouver l’oreille des Français. Elle passe par des solutions radicales pour répondre au vaste mouvement de dépossession qui touchent les Français depuis plusieurs décennies : dépossession politique, économique, sociale et identitaire. Il s’agit de proposer aux Français de reprendre le contrôle sur le destin de la France et sur leur vie. Face à l’instabilité qui menace, telle est la responsabilité de la droite.
Avec le pari à haut risque du Premier ministre François Bayrou qui demandera la confiance à l’Assemblée nationale le 8 septembre, voici donc la France prête à plonger une nouvelle fois dans l’instabilité politique. Cette errance, inquiétante en soi, aggrave encore la situation financière, économique et sociale d’un pays engagé sur la pente du déclin depuis plusieurs décennies. A n’en pas douter, les mouvements sociaux qui s’annoncent pour les prochaines semaines seront inflammables.
Sur le strict plan institutionnel, le président de la République porte une lourde responsabilité dans cet état de fait. Car, si la fragmentation électorale en trois blocs est d’abord le reflet de la division idéologique, politique et sociale des Français (ainsi que le résultat la défiance démocratique qu’on constate partout en Occident), force est de constater que le « dépassement » macronien, qui est au vrai un simplisme vénéneux pour la démocratie, aura pousser le pays à la crise de nerf et à ce qu’il faut bien regarder comme une crise de régime larvée.
Le paysage politique se trouve à la fois hérissé et désolé. Aucune combinaison imaginée par les états-majors et les médias n’est susceptible d’apporter un peu de stabilité. Du fait de la disparition du « fait majoritaire », même une nouvelle élection présidentielle ne serait pas la garantie d’un retour à la normale institutionnelle. L’hypercentre est discrédité et très puissamment rejeté. LFI montre un visage effarant, islamo-gauchisme, antisémitisme décomplexé et néo-socialisme en étendards. L’autre gauche (PS, PC et écologistes) patauge dans les contradictions et les chimères socialistes les plus éculée. Le Rassemblement national, premier parti de France et de loin, n’est sans doute pas capable d’obtenir une majorité absolue et beaucoup doutent de sa capacité à gouverner. La droite enfin, dont la macronie travaille à l’évaporation depuis sept ans, paraît à son point de non-retour.
Dans un pays qu’on dit majoritairement « à droite », peut-elle encore redresser la tête ? Est-elle vouée à disparaître ou peut-elle encore se métamorphoser ? A-t-elle encore un espace politique ? A-t-elle encore quelque chose à dire aux Français ? Pour répondre à ces questions, nous proposons un rapide coup d’œil sur les fautes et les échecs de la droite de ces quarante dernières années et esquissons une voie escarpée pour son renouveau.
•
Téléchargez la note d’actualité
•
L’auteur
|
Jean-Thomas Lesueur est directeur général de l’Institut Thomas More. Titulaire d’un Master d’histoire moderne (Paris IV Sorbonne), Il a débuté sa carrière comme rapporteur de groupe de travail à l’Institut Montaigne avant de participer à la création de l’Institut Thomas More en 2004. D’abord directeur des Études, il est devenu directeur général en 2007. Au sein de l’équipe de l’Institut Thomas More, il supervise le suivi de la vie politique française. Il s’intéresse en particulier aux blocages politiques et institutionnels propres au « modèle français », à la décentralisation et à la démocratie locale. Il réfléchit également aux questions migratoires et aux problématiques politiques liées aux enjeux culturels et identitaires en France et en Europe • |