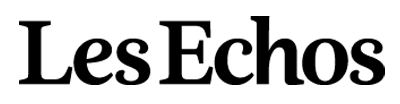30 septembre 2025 • Les Echos • Opinion •
Le retrait d’Orano du Niger a ravivé les craintes d’une pénurie d’uranium. Pourtant, explique Alban Magro pour Les Echos, c’est un faux problème masquant le vrai défi de notre souveraineté énergétique : les capacités industrielles de transformation du minerai.
Depuis un an, on entend beaucoup parler du Niger dès qu’il est question de nucléaire. Et pour cause, en juin 2024, Niamey a retiré à Orano son permis d’exploiter Imouraren, l’un des plus vastes gisements d’uranium au monde. Moins d’un an plus tard, la junte a franchi une nouvelle étape en nationalisant Somaïr, dernière mine encore en activité. De telles décisions ont fait renaître une interrogation obsédante : la France risque-t-elle de manquer d’uranium ?
La réponse est sans appel : non. En 2025, l’uranium consommé par la France provient de sources multiples et soigneusement diversifiées : Kazakhstan, Namibie, Ouzbékistan, Australie, Afrique du Sud. Au niveau européen, le Canada est même devenu le premier fournisseur en 2024, devant le Kazakhstan et la Russie. Les électriciens disposent de stocks qui couvrent plus de trois rechargements complets de réacteurs, soit plus de trois ans. Enfin, le minerai brut ne représente qu’une petite partie du coût d’un kilowatt-heure nucléaire. En clair : l’uranium naturel n’est pas le talon d’Achille de notre souveraineté énergétique.
Le vrai risque est ailleurs, et il est industriel. Transformer l’uranium en combustible passe par une chaîne de procédés complexes : conversion chimique, enrichissement, fabrication d’assemblages. Or ces étapes sont concentrées dans très peu d’usines dans le monde. En 2024 encore, près de 24 % des services d’enrichissement livrés aux électriciens européens venaient de Russie. Et l’Agence d’approvisionnement d’Euratom prévient : sans nouvelles capacités, la couverture contractuelle en conversion et en enrichissement s’effondre à partir de 2030. Dit autrement : ce n’est pas la mine qui menace, ce sont les usines.
C’est là que la France peut jouer une carte maîtresse. Avec Orano, elle possède l’un des rares acteurs mondiaux à maîtriser l’ensemble de la chaîne : conversion à Comurhex II, enrichissement à Georges-Besse II (Tricastin), fabrication à Romans (par Framatome). Ces briques industrielles sont uniques en Europe et reconnues dans le monde entier. Les Américains eux-mêmes viennent de confier à Orano des contrats stratégiques et l’accompagnent dans un projet d’enrichissement à Oak Ridge. C’est dire si notre savoir-faire est reconnu. Mais pour qu’il reste un atout, il faut changer d’échelle. L’extension en cours de l’usine du Tricastin, soutenue par un prêt de 400 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement, augmentera la capacité d’enrichissement d’environ 30 %. C’est majeur, mais très en deçà des besoins européens si l’on veut remplacer complètement les services russes. Les investissements nécessaires se chiffrent en milliards.
Faut-il attendre Bruxelles ? Certainement pas. L’Union européenne reste frileuse : malgré quelques signaux positifs (BEI, inclusion du nucléaire dans REPowerEU, inflexion de doctrine d’Ursula von der Leyen), la Commission avance au ralenti. Or le temps industriel n’attend pas. La bonne stratégie est claire : que la France avance d’abord et que l’Europe vienne amplifier ensuite. Paris doit sécuriser des contrats longs, agrandir Malvési et le Tricastin, développer Romans et ouvrir de nouveaux sites en France. Et sur cette base solide, ouvrir ces capacités à nos voisins pour substituer les flux russes et mutualiser les financements.
La souveraineté énergétique française se joue aujourd’hui moins dans le désert nigérien que dans nos usines de la Drôme. Le nucléaire fournissant la grande majorité de notre électricité, nous n’avons pas le luxe d’être dépendants de services russes ou chinois pour alimenter nos réacteurs. Surtout, accélérer l’aval du cycle n’est pas qu’un sujet de sécurité : c’est une manne financière. La valeur se crée dans la conversion, l’enrichissement et la fabrication : ce sont des contrats longs, à forte valeur ajoutée, non délocalisables, qui irriguent tout un écosystème (ingénierie, maintenance, équipements, chimie fine) de Romans à Tricastin et Malvési. Orano exporte déjà ce savoir-faire à l’échelle mondiale : la France en retire des recettes d’exportation régulières, améliore sa balance commerciale et sécurise des prix stables pour son industrie. Si nous investissons maintenant, nous transformons un risque en rente industrielle et technologique — emplois qualifiés, recettes fiscales, leadership européen. Si nous hésitons, nous prendrons le risque absurde d’avoir des réacteur… sans combustible pour les faire tourner.
En somme, mettons fin à la panique : l’uranium est disponible et les stocks existent. Le vrai sujet, c’est l’usine où se jouent à la fois la souveraineté et la valeur. La France fait partie des très rares nations maîtrisant l’ensemble de la chaîne avec Orano. Les champions industriels de rang mondial se font rares en France. Celui-ci est bien là : à nous d’investir sans hésiter, d’accélérer les capacités et de convertir cet atout technologique en emplois, en recettes d’exportation et en souveraineté durable.