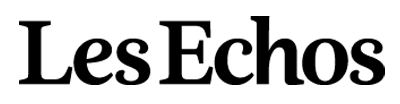23 novembre 2025 • Les Echos • Analyse •
La France célèbre ses licornes tandis que 70 % de ses infrastructures numériques critiques dépendent de technologies étrangères. Derrière le volontarisme affiché, la dépendance technologique s’est aggravée faute de stratégie industrielle cohérente, analyse Cyrille Dalmont, qui vient de publier le rapport Politique numérique d’Emmanuel Macron : le bilan.
Huit ans après le discours d’Emmanuel Macron sur la « start-up nation », le bilan de la politique numérique française est pour le moins contrasté. Derrière un volontarisme certain, la dépendance industrielle et technologique du pays s’est aggravée. La France compte aujourd’hui vingt-huit licornes, qui représentent environ 23 % de la capitalisation totale des licornes européennes et à peine 7 % à l’échelle mondiale. Ce succès apparent masque une réalité plus inquiétante : la seule entreprise technologique française classée parmi les cent premières mondiales occupe la 36ᵉ place, loin derrière les géants américains dont la capitalisation a, en moyenne, été multipliée par quatre depuis 2017. À elle seule, Nvidia pèse aujourd’hui l’équivalent de deux fois la capitalisation totale du CAC 40 (5 000 milliards de dollars).
Dans le secteur des semi-conducteurs, la France ne dispose plus d’aucun acteur dans le Top-10 mondial. STMicroelectronics, longtemps présent dans le classement, a été dépassé par les producteurs asiatiques et américains. Dans le cloud, la commande publique illustre le même déséquilibre : la majorité des marchés d’infrastructures de l’État ont été attribués à des fournisseurs non européens. Près de 70 % des infrastructures numériques critiques françaises reposent sur des technologies étrangères. Les centres de données installés en France ne représentent qu’une part marginale de la capacité mondiale, loin derrière les États-Unis et la Chine.
Cette situation ne résulte pas d’un manque d’initiatives mais d’une absence de cohérence. Les discours présidentiels sur l’intelligence artificielle, le quantique ou la cybersécurité n’ont jamais produit une stratégie industrielle intégrée, forte et claire. La politique de soutien à l’innovation a privilégié les start-ups et les services numériques au détriment des infrastructures, des composants et de l’énergie. Or une puissance numérique repose d’abord sur une base productive et énergétique stable : sans électricité pilotable et compétitive, aucune souveraineté technologique n’est durable.
L’écosystème français souffre également d’une fragmentation institutionnelle. Les agences publiques, les programmes européens et les structures régionales poursuivent des objectifs souvent redondants. Les financements demeurent dispersés et largement insuffisants, malgré les dispositifs Tibi et Tibi 2, dont l’effet de levier reste limité face aux plans d’investissement américains ou asiatiques.
À cela s’ajoute un environnement réglementaire devenu dissuasif pour les acteurs économiques. La norme, conçue pour garantir la sécurité et la conformité, est devenue un frein à l’expérimentation et à la prise de risque. Les entreprises consacrent une part croissante de leurs ressources à la conformité administrative plutôt qu’à la recherche ou à l’investissement. Ce climat de précaution permanente pèse sur la capacité d’innovation, particulièrement dans les secteurs régulés comme la santé, la défense ou les données sensibles.
Les contraintes européennes aggravent ce verrouillage. Le droit de la concurrence, pensé pour éviter les positions dominantes, empêche de constituer des acteurs de taille critique capables de rivaliser avec les géants américains ou asiatiques. Les règles d’aides d’État limitent strictement la politique industrielle et interdisent les préférences stratégiques dans les marchés publics. À cela s’ajoute l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce, qui proscrit toute préférence nationale dans la commande publique. Ce cadre, fondé sur une logique d’ouverture commerciale et de neutralité, neutralise les leviers essentiels de la souveraineté. Tant qu’il ne sera pas adapté, la France pourra multiplier les plans et les labels, elle ne disposera pas des outils nécessaires pour faire émerger ses propres champions.
L’e-administration aurait pourtant pu servir de moteur à la transformation numérique nationale. En structurant sa propre modernisation autour de technologies souveraines, l’État aurait pu créer une demande capable de soutenir une offre industrielle française. C’est l’inverse qui s’est produit : entre 2016 et 2025, la France est passée de la 10ᵉ à la 34ᵉ place mondiale dans le classement des Nations unies sur le développement de l’administration numérique. L’administration est devenue consommatrice de solutions étrangères plutôt que levier de développement national.
La France se félicite de ses start-ups quand elle perd son industrie : ce déséquilibre structurel traduit une priorité donnée à la communication plutôt qu’à la production. Une politique numérique cohérente devrait au contraire articuler production matérielle (hardware) et logicielle (software), politique énergétique, formation, commande publique stratégique et simplification réglementaire, afin de reconstituer un écosystème capable de soutenir durablement l’innovation et d’assurer la maîtrise de nos technologies clés.