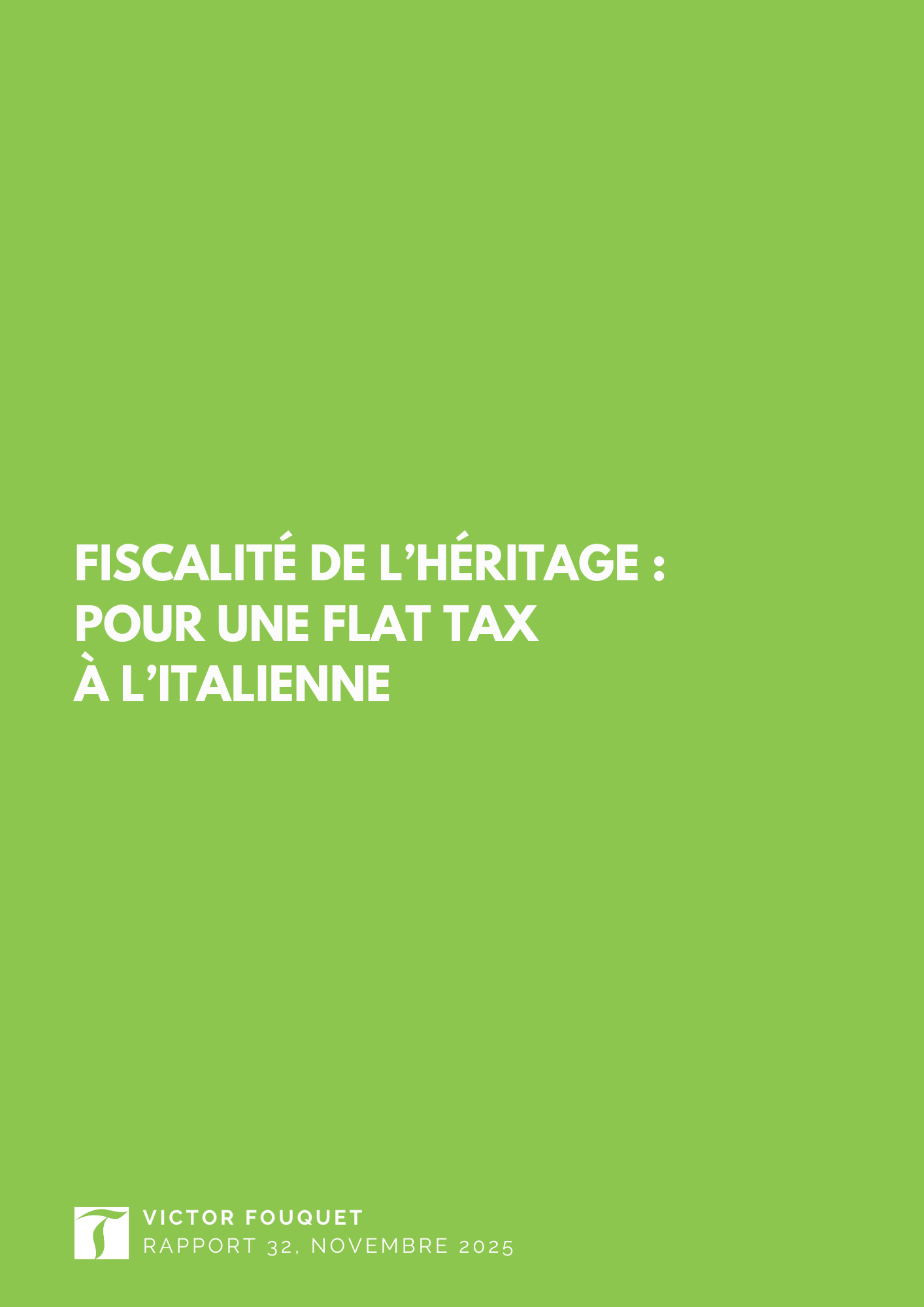Novembre 2025 • Rapport 32 •
Novembre 2025 • Rapport 32 •
Pour une réforme en profondeur de la fiscalité de l’héritage
Alors que la situation des finances publiques françaises est désormais critique, le débat parlementaire sur le budget 2026 voit ressurgir tous azimuts des propositions d’augmentation de la fiscalité sur l’héritage. Prenant acte que près de huit Français sur dix rejette l’idée d’un alourdissement des droits de succession, notre rapport a pour ambition d’apporter un peu de clarté dans le débat confus et souvent excessif en cours, en positionnant le sujet au bon niveau d’analyse et en dessinant les contours de ce que serait une réforme substantielle. Car, en opposant liberté de transmettre et souci égalitaire, la fiscalité de l’héritage sous-tend une conception de l’homme et de la société. Certains acteurs du débat défendent la suppression des droits de succession au nom du respect du droit de propriété, d’autres prônent leur renforcement pour limiter les inégalités. En pratique, les motivations à transmettre sont multiples, rendant les positions extrêmes inopérantes. Notre rapport plaide pour une réforme équilibrée inspirée du modèle italien de flat tax différenciée, simplifiant un système français trop complexe en vue de concilier efficacité économique et équité intergénérationnelle.

Philosophie(s) de l’impôt sur les successions et donations
La fiscalité de l’héritage cristallise un affrontement idéologique entre deux conceptions de la société : celle qui privilégie la famille comme vecteur naturel de solidarité et celle qui confie à l’État un rôle redistributif. D’abord conçu au début de la Révolution française comme un impôt proportionnel rémunérant un service public d’enregistrement, l’impôt sur l’héritage devient à partir de 1901 un impôt progressif de redistribution, marquant le passage d’un État régalien à un État social. Ce basculement affaiblit la solidarité familiale au profit d’une solidarité étatique. Il faut également noter que les systèmes fiscaux divergent selon les traditions : l’estate tax anglo-saxonne, fondée sur la liberté de tester, s’oppose à l’inheritance tax continentale, qui protège les héritiers réservataires. Si l’impôt successoral peut contribuer à l’égalité des chances, son efficacité économique et sociale reste discutée par les économistes : les héritages tendent en réalité à réduire les inégalités patrimoniales au sein d’une génération tandis que leur taxation, en ne touchant que le capital économique, ignore les autres formes d’inégalités.
Principaux constats sur les droits de succession et de donation
À l’échelle internationale, la tendance est à la réduction, voire à la suppression des droits de succession et de donation, souvent remplacés par d’autres formes d’imposition ou compensés par des exonérations élevées. Ce mouvement, amorcé dans les années 1970 (Canada, Australie), a ralenti depuis 2014, mais la majorité des pays de l’OCDE appliquent aujourd’hui des taux faibles et de nombreuses dérogations. Dans ce panorama, la France se distingue par une fiscalité très dynamique et complexe : ses recettes (0,74 % du PIB) figurent parmi les plus élevées au monde. Cette particularité s’explique par des barèmes fortement progressifs et une différenciation marquée selon les liens de parenté, frappant lourdement les transmis-sions en ligne collatérale ou entre non-parents. Malgré plusieurs avantages fiscaux (assurance-vie, démembrement de propriété, « pacte Dutreil »), le système français reste inégalitaire, punitif pour les héritiers éloignés et peu lisible, contrastant avec la simplicité et la modération observées dans la plupart des pays comparables.

Sept pistes pour une réforme
Forts de ces éléments d’analyse, nous proposons une réforme de la fiscalité de l’héritage afin de la rendre plus simple, plus proportionnelle et plus équitable entre les générations. Dans le débat de fond sur sa légitimité, nous proposons et assumons de (1) réformer et alléger l’impôt sur l’héritage sans le supprimer, en même temps que (2) nous rejetons formellement les idées à la mode de « dotation universelle en capital » et d’« imposition des successions et des donations tout au long du cycle de vie », lourdes de menaces pour le contribuable. La poutre maîtresse de notre proposition est (3) la simplification radicale de la structure d’imposition française en nous inspirant du modèle italien de flat tax différenciée, que nous accompagnons de quatre recommandations visant à (4) l’encouragement des donations afin de réduire les inégalités intergénérationnelles, (5) l’assouplissement de la réserve héréditaire afin d’offrir une plus grande liberté testamentaire, (6) la sanctuarisation du « pacte Dutreil » tout en supprimant le mécanisme de « purge » des plus-values latentes au moment de la transmission et, enfin, (7) la limitation aux actifs risqués du régime fiscal dérogatoire de l’assurance-vie, à défaut d’envisager sa suppression.
•
Téléchargez la note
•
L’auteur

Docteur en droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qualifié aux fonctions de maître de conférences (section droit public), Victor Fouquet est spécialisé en fiscalité et en analyse économique du droit. Il a reçu en 2024 le prix de thèse de la Société française de finances publiques pour sa Contribution à la théorie générale de l’impôt sur le revenu (thèse à paraître en février 2026 chez LGDJ dans la Bibliothèque de fiscalité et finances publiques). Ses travaux de recherche portent sur la science fiscale comme phénomène social « total » transcendant les disciplines du droit et des sciences sociales. Conseiller au Sénat, il enseigne le droit public financier et l’économie politique à l’Institut catholique de Paris • |