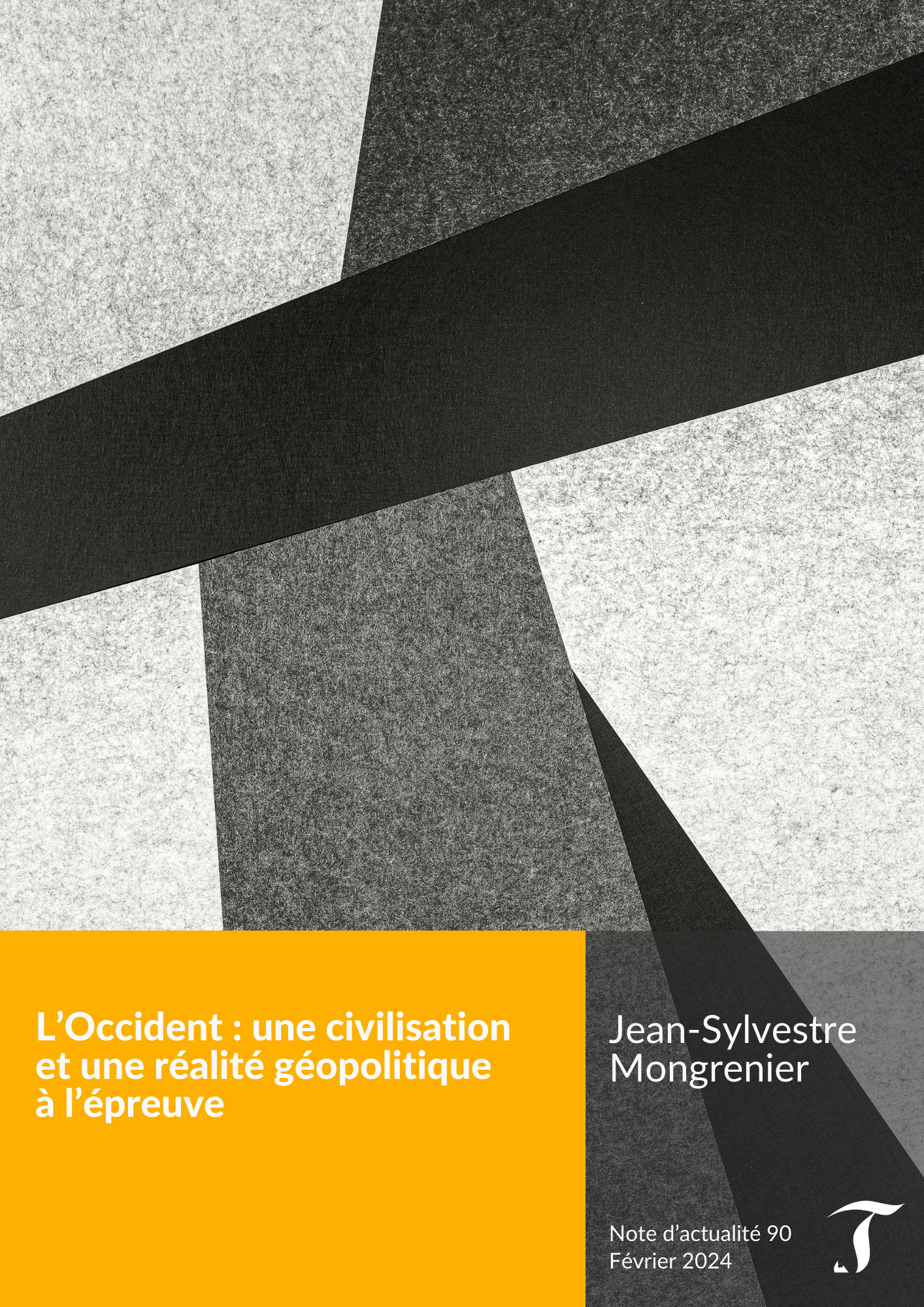Février 2024 • Note d’actualité 90 •
Février 2024 • Note d’actualité 90 •
Utilisée avec parcimonie, voire démonisée, la notion d’Occident est essentielle à l’intelligence de l’histoire universelle comme à celle des équilibres géopolitiques contemporains. De part et d’autre de l’Atlantique Nord et jusqu’aux antipodes, nombreux sont ceux qui voudraient ôter tout contenu concret et valeur objective à cette identité de civilisation. En d’autres termes, l’Occident ne serait qu’un discours autoréférentiel ; il n’existerait pas. En France, pendant longtemps le Quai d’Orsay s’est interdit d’employer le terme « Occident » (la France était « ailleurs »). Mais les puissances hostiles de l’axe eurasiatique et leurs alliés ne sont pas dupes de tels jeux de langage : Moscou, Pékin, Téhéran, d’autres encore, désignent l’Occident comme leur ennemi. Aussi le mot, la notion et les vertus qu’ils évoquent doivent-ils être réinvestis.
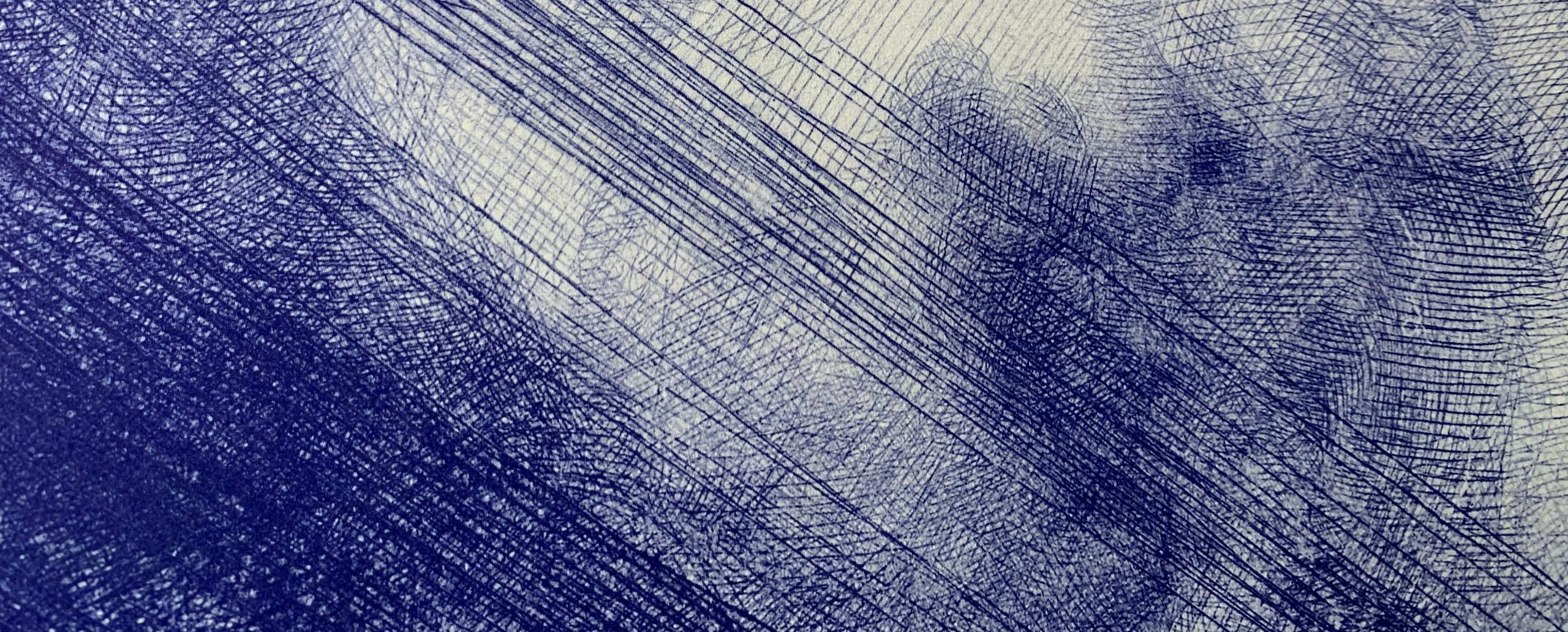
Le géonyme d’Occident est utilisé avec parcimonie, comme s’il était suranné ou réductible à une construction idéologique arbitraire, voire à un simple effet de langage. A moins qu’il ne s’agisse de mettre en accusation les peuples et les nations qui s’inscrivent dans la sphère de la civilisation occidentale ; le terme est alors utilisé pour le démoniser. Il serait pourtant difficile de penser le monde et l’histoire universelle en faisant l’impasse sur l’Occident, tant celui-ci, au cours des cinq derniers siècles, aura bouleversé la face de la Terre. Par ailleurs, les puissances qualifiées de révisionnistes, de « grands perturbateurs » aux vastes ambitions géopolitiques, ne doutent pas de l’existence de l’Occident lorsqu’elles affirment que leur « heure est venue », l’Orient et ses variantes (l’Eurasie) devant inéluctablement l’emporter. On notera enfin que l’emploi du terme sous nos cieux se fait plus fréquent. La gravité de la situation et les périls des temps présents provoqueraient-ils une anamnèse ?
Indubitablement, la notion d’Occident est complexe. Plus encore qu’un ensemble spatial aux limites historiquement variables, il s’agit d’une représentation de soi et du monde, d’une vue-du-monde, c’est-à-dire d’un ensemble de convictions et d’attitudes, de valeurs, d’idées et d’idéaux (une vue-du-monde mêle l’implicite et l’explicite, l’affectif et l’intellectuel). Enfin, la notion d’Occident est puissante et évocatrice : le mot claque comme un drapeau. « Occident » est bien plus polémogène qu’« Europe », terme pourtant proche sur le plan étymologique (« Ereb » signifie le Couchant, c’est-à-dire l’Occident). C’est pour cela qu’invoquer l’Occident provoque une certaine gêne dans le public, et même de la répulsion (la « défense de l’Occident » est honnie). Le terme rappelle les empires fondés outre-mer, la cosmologie impériale des nations occidentales ou, plus proche, la chute de Dien Bien Phu (9 mai 1954) et la guerre d’Algérie (1954-1962). On ne saurait pourtant se désintéresser de l’Occident : le mot, la notion, les vertus et les valeurs qu’ils évoquent doivent être réinvestis.
Généalogie et approches de l’Occident
Le géonyme « Occident » et sa signification
Si l’on se reporte à l’étymologie, l’Occident désigne le lieu où le soleil se couche et meurt (voir le latin occidere : tomber, ou encore le verbe français « occire »), c’est-à-dire la terre du Couchant, par opposition à l’Orient (voir le latin orior : naître), là où le soleil se lève (le Levant). L’opposition entre l’Orient et l’Occident recoupe celle de l’Asie et de l’Europe. De prime abord, le mythe d’Europe renvoie à un mouvement de translation d’est en ouest, Zeus taurin ravissant cette princesse de Phénicie pour l’emporter sur l’île de Chypre. De surcroît, « Europe » aurait pour origine un mot sémitique, Ereb, traduit par « soir » ou « couchant » . Quant au terme sémitique Assou, il désignait le lieu où le soleil se lève.
L’Europe et l’Occident seraient donc synonymes. Dès la Haute Antiquité, le terme Ereb est utilisé pour nommer les terres situées à l’ouest de l’Asie Mineure et des côtes phéniciennes : la Grèce d’abord, puis les contrées plus au nord et l’étendue continentale européenne. Notons ici que cette bipartition géographique Est-Ouest, à l’époque des guerres médiques (490-479 av. J.-C.), se double d’une opposition entre liberté et servitude : les libres cités grecques, rassemblées par Athènes, face à l’Empire perse, lui-même archétype du despotisme oriental (le concept de despotisme oriental est ultérieur). Depuis, cet antique topos est au cœur des représentations occidentales du monde. En somme, l’Occident est tout autant une région de l’être qu’une partie du monde, ce qui ne facilite pas le débat relatif à sa délimitation géographique et conceptuelle.
Sur les contours géohistoriques de l’Occident
Le géonyme d’Occident renvoie à une partie du monde dont les limites, appréhendées sur les temps longs de la géohistoire, ont varié. De plus, il est malaisé de circonscrire l’assiette spatiale d’une civilisation ou d’une vue-du-monde. La dyade Orient-Occident acquiert une signification politico-territoriale lors de la réorganisation de l’Empire romain, après la crise du troisième siècle. L’action de Dioclétien (il règne entre 284 et 305) préfigure la distinction de la pars orientalis et de pars occidentalis. A la mort de Théodose, en 395, la première revient à Arcadius, la seconde à Honorius, les fils du défunt empereur étant censés régner et gouverner en bonne intelligence. Bientôt, sous l’influence de forces centrifuges et la pression de différents peuples barbares, les destinées des empires romains d’Orient et d’Occident divergent. En 476, Rome tombe et la pars occidentalis est divisée entre plusieurs royaumes romano-germaniques. Par la suite, Charlemagne, en 800, puis Othon I, en 962, procèdent à une renovatio imperii : l’Empire d’Occident est restauré.
Sur le plan géographique, l’Occident médiéval qui prend alors forme correspond à la Chrétienté latine, séparée de la Chrétienté grecque depuis le schisme de 1054. Cet ensemble recouvre l’Europe occidentale puis, avec le Drang nach Osten des souverains germaniques, s’étend aux terres slaves d’Europe centrale. L’Occident du dixième siècle était encore sur la défensive (les Vikings au nord et à l’ouest, les Magyars à l’est et les Sarrasins au sud). Au regard de l’histoire universelle, l’Occident a l’allure d’un petit cap de l’Asie qui vit alors au rythme des steppes, dont il subit les invasions et les mouvements de peuples. Avec les croisades, il passe à la contre-offensive et se désenclave. Les guerres en Terre sainte familiarisent les croisés avec les techniques de navigation et les opérations expéditionnaires. Cette dynamique prépare les Grandes Découvertes qui donneront naissance à des « Europe (s) » d’outre-mer. L’Occident moderne constitue un ensemble spatial planétaire.
L’Occident sous l’angle stratégique et géopolitique
Centré sur l’Atlantique Nord, l’Occident au sens moderne du terme s’étend jusque dans l’océan Pacifique, en Australasie (Australie et Nouvelle-Zélande). Du fait de l’empreinte européenne et chrétienne, diverses contrées d’Amérique latine, voire d’Afrique, sont aussi un temps rattachées à l’Occident, sur le plan de la géographie culturelle et spirituelle. En expansion à l’époque des empires modernes, dits « coloniaux », le monde occidental n’en est pas moins divisé par les rivalités de puissance et les guerres internes. A l’issue de deux guerres mondiales, la situation change radicalement. Le centre de gravité de la puissance a « glissé » de la Vieille Europe vers les rives du Potomac et de l’Hudson River : les États-Unis confèrent une certaine unité géopolitique à l’Occident. Fondée le 4 avril 1949, l’Alliance atlantique, avec l’OTAN comme prolongement, constitue l’axe stratégique de l’Occident, le préambule du traité de l’Atlantique Nord contenant une profession de foi civilisationnelle explicite. Plus qu’une alliance classique, il s’agit d’un Grand-Espace (Großraum), assez conforme à ce qui fut pensé par Carl Schmitt, ce qui explique probablement la durée et la solidité de l’OTAN.
Outre les « démocraties maritimes » d’Australasie, des États tels que le Japon, la Corée du Sud et Taïwan sont intégrés au système des alliances américaines et font figure de « membres honoraires » de l’Occident. Il en va de même de la Turquie néo-kémaliste, membre de l’OTAN à partir de 1952 (comme la Grèce). Plus encore après la Guerre froide, l’Occident prend l’allure d’une vaste confédération de « démocraties de marché » (selon l’expression des politistes américains), qui s’étend désormais aux nations d’Europe centrale, l’« Occident kidnappé » de Milan Kundera. Sur le théâtre Indo-Pacifique, les alliances sont rehaussées – voir le triangle Washington-Tokyo-Séoul ainsi que l’AUKUS (l’alliance Washington-Londres-Canberra) –, et complétées par le Quad, une structure de coopération qui inclut l’Inde (États-Unis, Australie, Japon, Inde). Les contours de ces alliances et formats de coopération dépassent ceux de l’Occident mais ils ont tous pour moteur les États-Unis, héritiers des pouvoirs historiques autrefois exercés par les puissances impériales européennes.
L’Occident comme civilisation
Sur la notion de civilisation
Avant de se transformer en un ensemble stratégique et géopolitique emmené par les États-Unis, ces derniers y assumant la fonction de « stabilisateur hégémonique », l’Occident constitue une civilisation. Au prétexte que les civilisations ne constituent pas des acteurs géostratégiques stricto sensu, avec des frontières tirées au cordeau, la réalité de ces ensembles géoculturels est souvent relativisée, voire purement et simplement niée. Ainsi se souvient-on des réactions suscitées par la thèse de Samuel P. Huntington sur le « choc des civilisations ». Comme s’il n’y avait rien entre la nation et l’humanité. Pourtant des historiens tels qu’Arnold Toynbee ou Fernand Braudel ont mis l’accent sur les civilisations, les économies-mondes et les systèmes impériaux qui dépassent et englobent ethnies, peuples et nations.
Au demeurant, la civilisation, au singulier, est d’abord définie comme un processus historique. Le terme est attribué à Turgot qui, en 1756, désigne ainsi l’accès d’un groupe humain à l’état civil, c’est-à-dire une structure politique, des institutions, un État de droit, par opposition à l’état de nature (Mirabeau père reprend en 1762 le terme de « civilisation »). Cette évolution atténue la violence originelle de l’état de nature, étant entendu qu’une régression est toujours possible (voir le thème de la « décivilisation », en référence aux travaux de Norbert Elias sur la civilisation des mœurs, comme dynamique de l’Occident). C’est au dix-neuvième siècle que la notion de civilisation prend un sens ethnographique. Sous l’influence de la philosophie de l’histoire de Herder et du romantisme, la civilisation devient Kultur : elle désigne l’ensemble des traits ethno-linguistiques, culturels et moraux d’un groupe humain. Selon cette définition, l’humanité se répartissant en de vastes aires géographiques qui regroupent plusieurs peuples, nations et cultures, apparentés par leur origine ou par la diffusion d’un certain nombre de traits anthropologiques depuis un grand foyer culturel.
« Athènes, Rome et Jérusalem » (Paul Valéry)
En ce sens, civilisation se conjugue au pluriel, les civilisations correspondant à différentes modalités d’existence humaine. Et l’on n’aura pas attendu Samuel P. Huntington pour comprendre que ces civilisations croissent et se développement dans un contexte pour partie fait de compétions, de rivalités et d’affrontements. Dans Le regard éloigné, paru en 1983, Claude Lévi-Strauss en parle comme la condition sine qua non de la diversité du monde. La civilisation occidentale est donc l’un de ces ensembles géoculturels parmi d’autres, si ce n’est qu’elle est l’héritière d’une histoire sans équivalent. A partir d’une portion limitée des terres émergées, l’Europe, cette civilisation a étendu son action, son pouvoir et son influence à l’échelle du Globe. Le dynamisme planétaire et séculaire de l’Occident ne facilite pas la définition de cet ensemble géoculturel, à la fois un et multiple.
A la manière de Paul Valéry (« Athènes, Rome et Jérusalem »), nous insisterons sur le fond culturel gréco-romain et l’eschatologie biblique, sans omettre cependant les héritages celtiques, germaniques et slaves (sur ce point le courant culturel romantique du dix-neuvième siècle corrige le classicisme du siècle précédent). Au cours du Moyen Âge occidental, le christianisme est le ferment d’une conscience commune, fondée sur une certaine idée de l’homme, du temps et des fins dernières. Le développement des villes et des universités, l’expansion des réseaux marchands, l’esprit de Croisade aussi, porté par des ordres de moines guerriers, impriment leur marque sur l’Occident moderne. Longtemps influencée par le matérialisme et l’économisme, l’historiographie des Grandes Découvertes prend désormais en compte l’influence des idéaux religieux et du messianisme sur le grand élan maritime et océanique de cette époque de transition entre le Moyen Âge et les Temps modernes (voir par exemple la quête du royaume du Prêtre-Jean).
De l’ancien au nouvel Occident
L’Occident, au sens moderne du terme, commence donc à prendre forme avec les Grandes Découvertes qui ouvrent une première mondialisation (la « mondialisation ibérique »). Il a partie liée avec le grand large. En Europe, l’ordre public international ne repose plus sur l’unité et la cohésion de la Chrétienté mais sur l’équilibre des forces, le machiavélisme raisonné des chancelleries cherchant à l’imiter l’ampleur des guerres interétatiques.
Au-delà des anciens parapets et des « lignes d’amitié » (Lines of Amity), le droit des gens ne s’applique plus et les conflits entre les puissances maritimes et impériales de l’Ancien Monde sont sans merci. L’enjeu est d’accumuler pouvoir, puissance et richesses afin de peser de manière décisive en Europe et d’y remodeler en sa faveur les rapports de force. Sur fond de « révolution militaire », d’expansion coloniale et de développement du capitalisme (l’Asie et les Amériques sont intégrées au système économique européen), les puissances occidentales définissent le « nomos de la Terre ».
Ce faisant, l’Occident se transforme. L’ordre westphalien se substitue à la Chrétienté, l’État moderne s’impose, puis le libéralisme renouvelle les régimes politiques intérieurs. L’Occident contemporain, celui de notre modernité tardive, est le produit de ces siècles d’histoire. Selon une approche exceptionnaliste, Samuel P. Huntington et Niall Ferguson sélectionnent certains traits de civilisation qui singularisent l’Occident, face au « reste du monde ». Dans Qu’est-ce que l’Occident ?, Philippe Nemo mène une étude historico-philosophique précise, sur la longue durée. Enfin, Henri de la Bastide définit l’Occident comme une « civilisation de la personne », fondée sur l’idée de l’homme comme agent moral : un être dont le libre arbitre le rend capable de distinguer le mal du bien, de vouloir le bien et de l’aimer (le libre conseil et le libre plaisir).
L’Occident en péril
Menaces externes et internes
On rappellera ici les périls qui pèsent aujourd’hui sur l’Occident comme forme géopolitique, sur les frontières orientales de l’Europe et de l’OTAN, où l’armée russe fait la guerre à l’Ukraine, au Moyen-Orient, livré aux agissements de l’Iran et de ses alliés et affidés, ainsi que dans les « Méditerranées asiatiques » (mers de Chine du Sud et de l’Est) et sur le théâtre Indo-Pacifique, où la Chine populaire cherche à opérer une percée géopolitique.
De l’Ukraine au détroit de Taïwan, et sur le boulevard moyen-oriental de l’Eurasie, Moscou, Téhéran et Pékin ont constitué un axe de puissances perturbatrices, renforcé par Pyongyang en Asie du Nord-Est. Ce quatuor coordonne stratégies et manœuvres afin de briser l’’unité transatlantique et de contraindre les puissances occidentales au grand repli, les Américains sur la partie nord de l’hémisphère occidental, les Européens sur leur « petit cap de l’Asie ».
Cette pression extérieure est aggravée par la crise de civilisation que traverse l’Occident, en proie à l’hypercriticisme. Certes, la tradition critique n’est pas nouvelle – « L’Europe de la mauvaise conscience, souligne André Reszler, naît au cœur de l’Europe conquérante » –, mais depuis le siècle dernier, la mauvaise conscience n’est plus le contre-effet d’un dynamisme impérial. Ce « culpabilisme » est un complexe, au sens pathologique du terme, une sorte de dépression immunitaire. Notons que ce complexe était déjà identifié au détour des dix-neuvième et vingtième siècles. Dans Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885) et Généalogie de la morale (1887), Nietzsche accablait les « prophètes de la grande fatigue » et les « phtisiques de l’âme », ou encore « le dernier homme ». Puis Freud, dans Totem et tabou (1913) et Au-delà du principe de plaisir (1920), identifiait une « pulsion de mort » qui déterminerait en profondeur le sentiment de culpabilité. Par la suite, cette pathologie fut nourrie par de grands alibis collectifs tels que l’anticolonialisme et le tiers-mondisme (le « post-colonialisme » s’inscrit dans cette postérité). Face au « reste du monde », les développements contemporains de ces pathologies handicapent l’Occident et affaiblissent l’action politico-stratégique des États qui relèvent de cette civilisation.
Déclin ou décadence ?
Aussi la question d’Occident est-elle celle de son déclin, voire de sa décadence. En vérité, la question date de la fin de l’Empire romain, la conscience eschatologique et l’angoisse de la décadence constituant les ressorts de renaissances successives. Le déclin est d’ordre économique et quantitatif. Il implique la réduction du pouvoir d’agir d’une unité politique, son rétrécissement. Le déclin est donc relatif, c’est dire qu’il s’éprouve par comparaison aux unités politiques rivales. La décadence est plus difficile à saisir car elle porte sur la désagrégation des normes et des valeurs du groupement humain considéré, cité, nation, empire ou civilisation. En cela, elle n’est pas mesurable. Il reste que les deux phénomènes se recoupent et sont interdépendants. Dans la présente problématique, déclin et décadence doivent être envisagés selon deux ordres de grandeur, le cas des États-Unis n’étant pas exactement celui de l’Europe. A l’issue des deux dernières guerres mondiales, celle-ci a connu un déclin évident. En deux décennies (la décolonisation, 1945-1965), les nations impériales européennes ont perdu l’essentiel de leurs positions extérieures, acquises au fil des siècles. Dans La fin de la renaissance, Julien Freund souligne le caractère exceptionnel de cette grande retraite géopolitique.
A l’échelle de l’Occident, ce phénomène est largement contrebalancé par la « superpuissance » des États-Unis qui, désormais, assument le rôle de stabilisateur hégémonique. L’avenir de cette superpuis-sance, toujours prédominante mais dont les lignes de fracture internes inquiètent, pourrait avoir de graves répercussions externes. Si le lien transatlantique ne résistait pas à une poussée isolationniste américaine, il est à craindre que l’Europe redevienne un « petit cap de l’Asie », les puissances pertur-batrices extérieures instrumentalisant ses divisions. Toujours est-il qu’à Moscou, Pékin et Téhéran, entre autres capitales, on spécule sur la décadence de l’Occident, présentée comme inéluctable.
« Défi-et-réponse » (Arnold Toynbee)
Certes, la variété et la multiplicité des critères à prendre en compte pour poser un tel diagnostic, celui d’un déclin et même d’une décadence de l’Occident, obligent à la prudence. D’autant plus que les décadences absolues, conduisant à l’effondrement final, sont rares dans l’histoire. Il n’en reste pas moins que cette perception extra-occidentale est un fait psychique. D’aucuns voudront rassurer : « Ce n’est que psychologique ». Mais les faits psychiques entraînent des conséquences dans le monde empirique. C’est pour cela que la discipline géopolitique porte une grande attention au poids et à la dynamique des représentations dans les conflits entre pouvoirs, pour et sur des territoires.
Par ailleurs, les pays occidentaux sont confrontés à de nombreux défis et menaces, avec pour toile de fond un déplacement des équilibres de puissance et de richesse vers l’Asie. Face au regroupement de puissances perturbatrices hostiles, solidarisées par un jeu d’alliances informelles et de partenariats, les pays européens souffrent des conséquences du désarmement unilatéral auxquels ils ont consenti, au prétexte de toucher les « dividendes de la paix ». Et le surendettement de nombre d’entre eux réduit leur latitude d’action et leur réactivité. A la différence de l’Union européenne et de ses États membres, les États-Unis conservent leur poids relatif dans l’économie mondiale et leur puissance militaire demeure écrasante. Sollicités en Europe, au Moyen-Orient et sur le théâtre Indo-Pacifique, ils n’en sont pas moins exposés aux périls de la « surextension stratégique ». Et la partie géopolitique se joue également dans le « Sud global », chambre d’échos des discours anti-occidentaux et terrain de manœuvre de puissances hostiles.
L’illusion d’un monde multipolaire ordonné et stable se déchire, une nouvelle bipolarité Orient-Occident se profilant à l’horizon. Une telle configuration appelle réponse, notamment dans l’ordre de l’esprit. Sur ce point, l’étude d’Arnold Toynbee est plus revigorante que celle d’Oswald Spengler, pour lequel la décadence est une fatalité (la seule issue est en quelque sorte le suicide stoïcien). Le grand historien anglais fait du schéma « challenge-and-response » le modèle explicatif de la palingénésie des civilisations : les épreuves imposées aux sociétés humaines sont des stimulants qui appellent des réponses à la hauteur et nourrissent la croissance des civilisations.
L’Occident peut être vaincu par lui-même
En guise de conclusion, nous ferons part de notre conviction selon laquelle l’Occident ne peut être vaincu que par lui-même, plus exactement par la démotivation et le nihilisme, la démission et le renoncement à lutter contre les forces d’autodestruction. Sous cet angle, le plus grave n’est pas le relatif rééquilibrage des forces politiques, économiques et militaires au plan mondial (au détriment de l’Europe plus que les États-Unis), mais la carence du sacré, ou plutôt l’éclipse du divin (« Dieu n’est pas mort, il s’est retiré. »). « Perte de force du symbole chrétien » (Carl G. Jung) ou « grand renoncement » (Chantal Delsol) ? Quoiqu’il en soit, l’effondrement spirituel des sociétés occidentales de la modernité tardive a causé une réduction de la stature humaine, redoutable de conséquences à l’heure des grands périls, quand la conservation de l’être pourrait être en jeu. De fait, la guerre d’Ukraine ne saurait être le simple support d’effets de style sur le « retour du tragique » ou, selon, « retour de l’Histoire ».
De fait, une possible extension de la guerre d’Ukraine (une double escalade, verticale et horizontale) révèlerait les failles anthropologiques majeures des sociétés occidentales post-modernes, plus graves que les problèmes économiques ; elles relativiseraient les déficiences logistiques et industrielles des systèmes productifs occidentaux, que l’on prétend par ailleurs vouloir (non sans emphase) transformer en « économies de guerres ». Aussi serait-on tenté d’en appeler à une renaissance spirituelle, si cela ne résonnait pas comme le leitmotiv de l’impuissant. De fait, ces choses ne se décrètent pas. En revanche, il importe de vouloir établir un diagnostic solide sur la situation des nations occidentales et, en suivant une thérapie de la lumière, de décrire et expliquer les menaces auxquelles elles sont confrontées. Ni volontarisme vain consistant à se poser en « petit dieu », maître du monde et grand horloger de l’Histoire, ni résignation à l’impuissance. Mais un exercice de lucidité, indispensable préalable à une action en profondeur et de longue portée.
•
Téléchargez la note d’actualité
•
L’auteur

Jean-Sylvestre Mongrenier est directeur de recherche à l’Institut Thomas More. Titulaire d’une licence d’histoire-géographie, d’une maîtrise de sciences politiques, d’un DEA en géographie-géopolitique et docteur en géo-politique, il est professeur agrégé d’Histoire-Géographie et chercheur à l’Institut Français de Géopolitique (Université Paris VIII Vincen-nes-Saint-Denis). Il est conférencier titulaire à l’IHEDN (Institut des hautes études de la dé-fense nationale, Paris), dont il est ancien auditeur et où il a reçu le Prix Scientifique 2007 pour sa thèse sur « Les enjeux géopoli-tiques du projet français de défense euro-péenne ». Officier de réserve de la Marine na-tionale, il est rattaché au Centre d’Enseigne-ment Supérieur de la Marine (CESM), à l’École Militaire. Il est notamment l’auteur de Le Monde vu de Moscou. Géopolitique de la Russie et de l’Eurasie postsoviétique (PUF, 2020), Géopolitique de la Russie (avec Françoise Thom, PUF, 3e édition, 2022), Géopolitique de l’Europe (PUF, 2e édition, 2023), et de Le Monde vu d’Istanbul. Géopolitique de la Turquie et du monde altaïque (PUF, 2023) • |
•