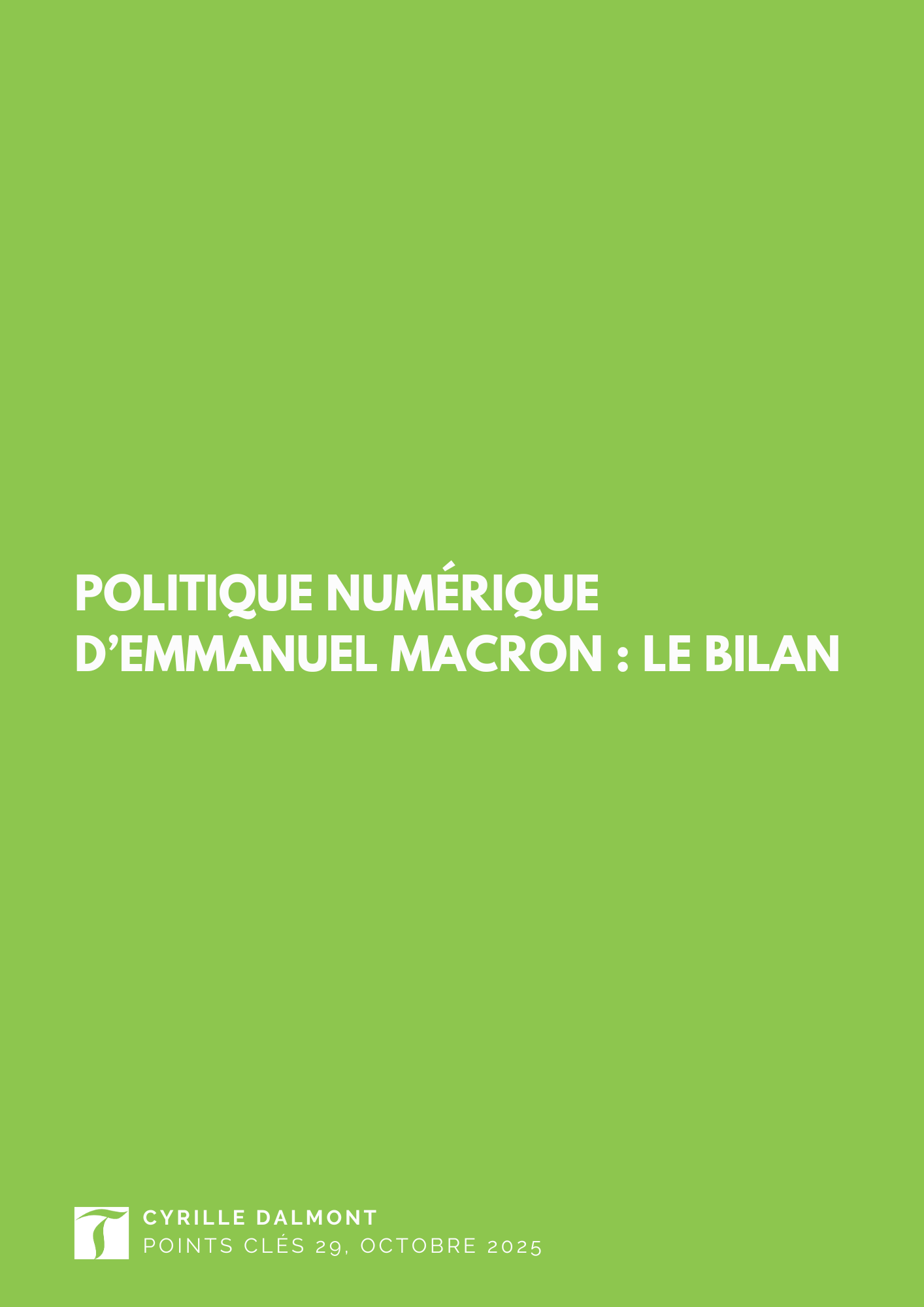Octobre 2025 • Points Clés 29 •
Octobre 2025 • Points Clés 29 •
Les raisons d’un bilan
Dans les principaux classements internationaux liés au numérique (nous en citons six), la France occupe une position globalement médiocre. Malgré les ambitions importantes affichées en la matière par Emmanuel Macron depuis 2017 et une communication soutenue autour de l’innovation, le bilan que dresse ce rapport est décevant. L’absence de stratégie cohérente et de choix structurants, des initiatives nombreuses mais éparses conduisent après huit années à un constat inquiétant : celui d’un écosystème numérique français faible, marqué par des dépendances accrues et une perte de souveraineté. Notre étude révèle la nature essentiellement incantatoire de la posture volontariste mais impuissante du président.
Vision et discours : huit années entre volontarisme et incantations
Entre 2017 et 2025, Emmanuel Macron a multiplié les discours ambitieux sur le numérique (nous en listons 23), s’affichant en promoteur de la « start-up nation » et d’une France leader de l’innovation. Il adopte au départ une posture extrêmement allante et pro-business, avec les salons VivaTech en Choose France comme vitrines de la nouvelle attractivité française. Mais dès 2018, on observe une inflexion significative : la régulation, principalement européenne, devient le nouveau paradigme de son discours. Les années suivantes, la vision se fait confuse, les annonces spectaculaires se multiplient (sur le quantique, la cybersécurité, l’IA, les licornes), pas toujours suivies d’effet. Le président de la République martèle que l’UE va se muer en puissance grâce à sa force régulatrice mais, concrètement, la dépendance numérique croît dans tous les domaines. Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla, X) se succèdent à l’Élysée mais les photos-souvenirs n’y changent rien : la France accueille les géants du numérique venus d’ailleurs, elle n’en crée pas.

Souveraineté industrielle : du mirage à l’échec
Malgré des milliards investis (STMicro à Crolles, plan France 2030, Chips Act européen), la France n’a pas renforcé sa souveraineté industrielle pendant ces huit années. Elle reste absente des technologies critiques (puces avancées, cloud, réseaux, cybersécurité) et dépend d’acteurs étrangers. STMicro, relégué au 9e rang mondial, peine à innover. Le cloud reste dominé par AWS ou Azure. Si quelques initiatives structurantes ont émergé au cours de ces années en matière de cybersécurité, elles ne compensent pas notre fragilité structurelle : la France reste « locataire » de son écosystème numérique dont la propriété réelle appartient à des puissances étrangères.
Politique énergétique : des choix qui obèrent toute ambition numérique
La politique énergétique européenne a contribué à nous déclasser industriellement. Car sans électricité abondante, pas de puissance numérique. Les États-Unis produisent 4 400 TWh par an, l’Europe seulement 2 700TWh. Sa politique, fondée sur la sobriété et les énergies intermittentes, ignore obstinément les besoins croissants du numérique (centres de données, IA, véhicules électriques, etc.).

Financement privé et capitalisation : des efforts insuffisants
Un écosystème numérique de rang mondial ne peut exister sans capitaux abondants. Le déficit d’épargne orientée business et de capitaux longs en France et en Europe est largement documenté. L’initiative Tibi va dans le bon sens mais pèse à peine autant qu’un seul tour de table américain. La France compte 28 licornes, encore loin de l’objectif de 100 d’ici 2030, souvent financées par des fonds étrangers. L’UE, avec 111 licornes, reste très en retard par rapport aux 690 américaines (dont la valorisation est 8,5 fois supérieure).
Régulation : une hypertrophie française et européenne qui désarment l’État et les entreprises
Depuis 2017, la France et l’UE ont misé sur une régulation « protectrice » mais qui a pour effet la paralysie de l’initiative et de l’innovation. RGPD, DSA, DMA, IA Act, NIS 2 imposent des obligations identiques aux start-ups qu’aux GAFAM. Résultat : complexité juridique, pénalisation de l’innovation et dépendance aux géants étrangers. En France, le coût de cette complexité est évalué entre 100 et 150 milliards d’euros par an. Les États-Unis et la Chine ont au contraire fait de la régulation un levier de puissance.

Commande publique : un stimulant économique négligé
La commande publique française, forte de 179 milliards d’euros par an, reste un levier stratégique sous-exploité, notamment dans le numérique (qui représente seulement 10 % des montants). Faute de doctrine, l’État favorise indirectement les GAFAM via des plateformes comme l’UGAP, où les offres de Microsoft ou AWS dominent. Les entreprises françaises, en particulier les PME, souvent absentes, sont évincées par des exigences contractuelles complexes. L’interdiction de toute préférence nationale, issue du droit européen, empêche toute stratégie souveraine.
Formation et recherche : un déclassement inquiétant pour demain
Malgré les nombreux engagements d’Emmanuel Macron, la France reste à la traîne en matière de formation et de recherche. Avec des réformes marginales et sans écosystème éducatif, le numérique scolaire est embryonnaire. Avec 60 % des actifs qui manquent de compétences numériques, la formation continue est à la traîne. Dans le QS World University Rankings 2026, notre pays ne compte que quatre universités dans la catégorie « Ingénierie & Technologie », une en « Informatique » et zéro en « Science des données et IA ».
•
Téléchargez la note
•
L’auteur

Cyrille Dalmont est directeur de recherche à l’Institut Thomas More. Titulaire d’un master de droit public (université Jean Moulin Lyon 3) et d’un master en administration publique (université de Poitiers), il est ancien conseiller parlementaire à l’Assemblée nationale et ancien chargé de mission dans une grande métropole française. Il a aujourd’hui rejoint le secteur privé. Au sein de l’Institut Thomas More, il analyse les mutations politiques, économiques et sociales provoquées par la numérisation massive de nos sociétés. Ses recherches portent actuellement sur deux axes principaux : les questions de régulation et les enjeux éthiques liés au déploiement du numérique et son impact sur les droits fondamentaux et les libertés publiques ; ainsi que les enjeux de souveraineté numérique, tant au niveau national que de l’Union européenne. Il a notamment publié les deux rapports suivants : L’impossible souveraineté numérique européenne : analyse et contre-propositions (avril 2021) et La stratégie énergétique européenne aura-t-elle raison de l’écosystème numérique européen ? (janvier 2024) • |